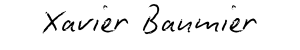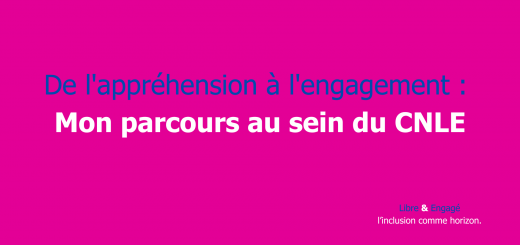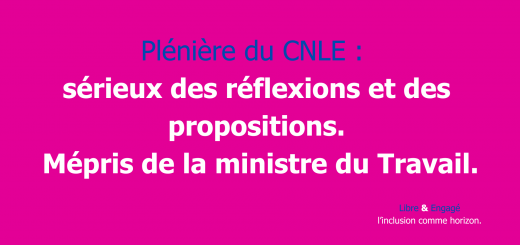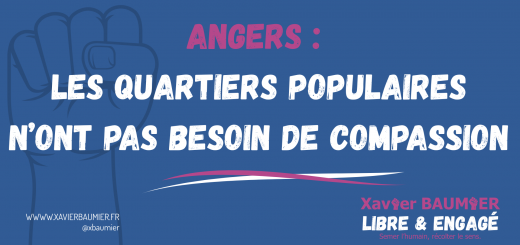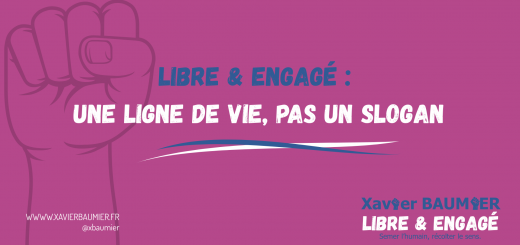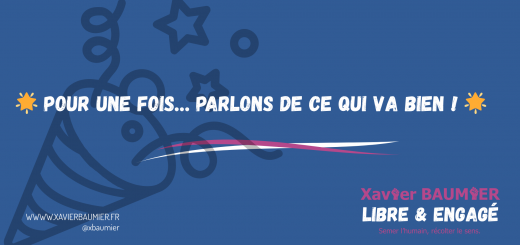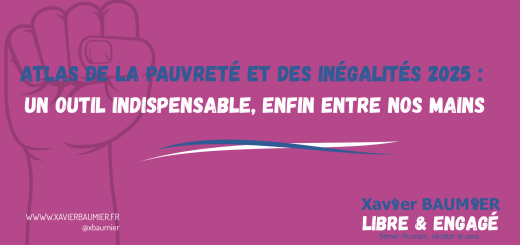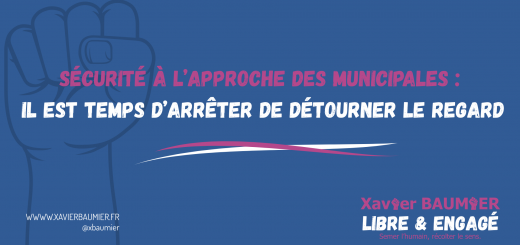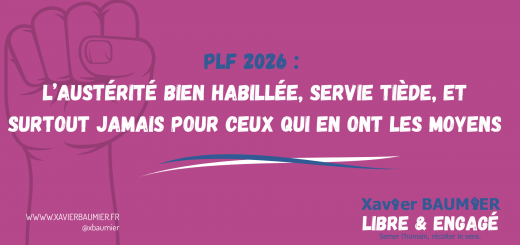CNLE : Présents à Paris, absents en territoire ?
par Xavier BAUMIER · Publié · Mis à jour
Ah, être nommé au CNLE… Trois lettres qui claquent comme une médaille républicaine sur le revers d’un militant de terrain. On s’imagine déjà en haut de l’affiche, au cœur des politiques publiques, dans les petits papiers des ministères. On visualise le rôle de conseiller de l’ombre, inspirateur de grandes réformes, guide éclairé de la lutte contre l’exclusion.
Spoiler alert : dans la vraie vie, c’est un peu plus flou.
Parce qu’une fois le décret de nomination ouverte avec émotion (et postée fièrement sur Facebook), la suite ressemble à un circuit touristique réservé aux grands engagés : Paris Gare Montparnasse, métro ligne 12 rue olivier de Sers, badge temporaire, salle Dehly, salle Sydney, salle Londres… PowerPoint, café froid, visio capricieuse, et puis retour à la maison avec la tête pleine de « stratégies transversales » et de « diagnostics participatifs ».
Oui, on voit du pays. Enfin… on voit surtout Paris. Et dans Paris, on voit surtout le ministère. On commence à connaître les interrupteurs des salles de réunion par leur petit nom.
Mais à part ça, à quoi sert-on, nous, membres du CNLE ?
C’est LA grande question.
Parce que sur le papier, on est censés représenter la parole des premiers concernés. On est censés faire remonter les réalités de terrain, nourrir les politiques publiques avec du vécu, du vrai. On est censés être les relais d’une démocratie sociale plus vivante, plus connectée, plus incarnée.
Mais dans les faits ? Qui, dans les territoires, sait que nous existons ? Qui nous identifie, nous sollicite, nous considère comme des partenaires à part entière ?
Même dans certaines Directions départementales, on nous regarde comme des OVNIs. « Le CNLE ? Ah oui… c’est un syndicat, non ? »
Non. Ce n’est pas un syndicat. Ce n’est pas non plus un club de réflexion. Ce n’est pas un séminaire permanent à Paris. C’est un Conseil national, oui, mais qui devrait être localement utile, territorialement ancré, visible, mobilisé.
Et c’est là que le bât blesse.
L’ancrage territorial, ce concept aussi flou qu’essentiel
Alors oui, il existe une commission au CNLE sur l’ancrage territorial. Elle bosse, elle produit, elle réfléchit. On adore. Mais pendant ce temps, sur le terrain, c’est le désert. Les membres du CNLE sont là, motivés, compétents, disponibles. Mais personne ne frappe à leur porte.
Il y a là une erreur de casting démocratique. Ou plutôt un manque d’organisation : on nomme des personnes avec un savoir d’usage, une expérience, une intelligence du réel… et on les laisse inconnues au bataillon dans leur propre département. Parfois même, leurs propres élus ne savent pas qu’ils siègent à un conseil national.
C’est un peu comme envoyer un pompier dans une maison en feu, mais sans lui dire où est le tuyau d’arrosage.
Alors, que faire ? Sortir du rôle de figurant
Non, la participation ne doit pas être un prétexte. Un alibi qu’on brandit pour faire joli dans les rapports d’évaluation. Elle ne doit pas se cantonner à Paris intra-muros ou aux visioconférences mal sonorisées. Elle doit être vivante, territorialisée, mise en lien avec les services de l’État. Préfets, DDETS, CCAS, élus locaux… il est temps que vous sachiez que les membres du CNLE sont là, chez vous, dans vos départements, au service du bien commun.
C’est maintenant qu’il faut ouvrir des portes, créer des synergies, impliquer les membres du CNLE dans les concertations locales, les comités de pilotage, les évaluations de politiques publiques.
Bref, sortir du rôle de spectateur pour redevenir acteur, et pourquoi pas co-auteur des politiques de solidarité.
Parce qu’être nommé au CNLE, c’est bien.
Mais être utile au pays, à ceux qui en ont besoin, c’est encore mieux.