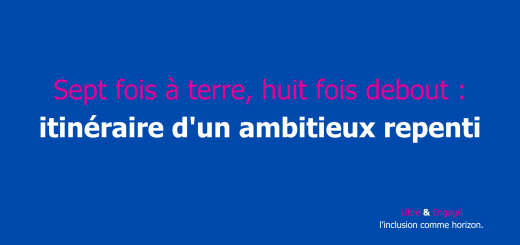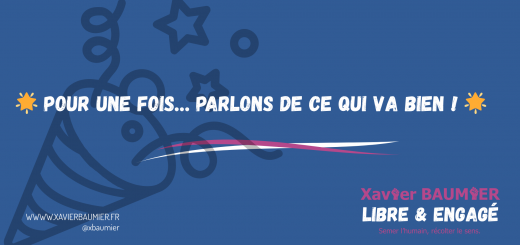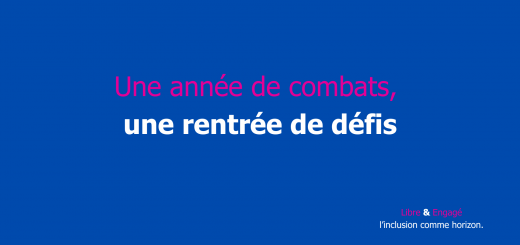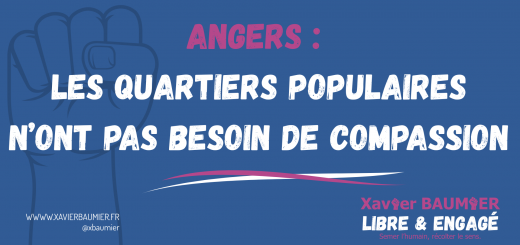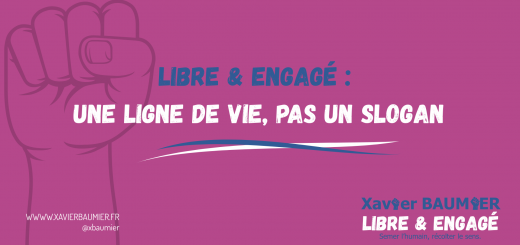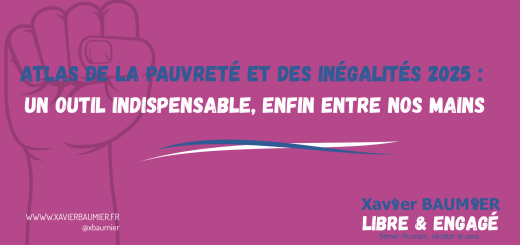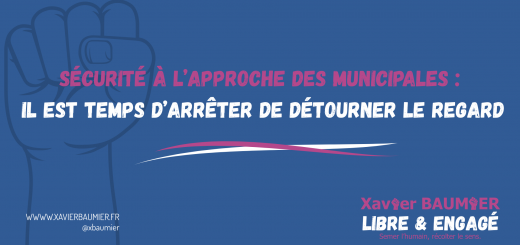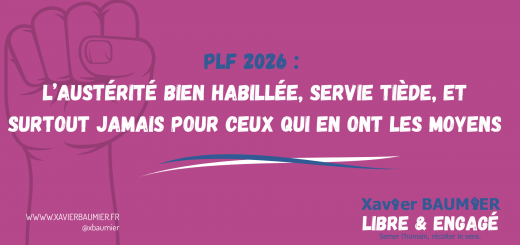Donner de la visibilité aux invisibles
par Xavier BAUMIER · Publié · Mis à jour
Qu’ont en commun l’allocataire du RSA qu’on n’écoute jamais, le jeune en contrat d’insertion dont l’avis ne compte pas, ou la mère célibataire en situation précaire qu’aucune politique ne semble viser ? Leur invisibilité sociale. Pourtant, ce sont elles et eux qui vivent les politiques publiques de solidarité au quotidien. Ils en subissent les lacunes, parfois les violences institutionnelles. Et souvent, ils n’ont pas voix au chapitre.
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) s’est donné pour mission de faire de ces invisibles des acteurs à part entière. Donner de la visibilité à ceux qu’on n’écoute pas, c’est une question de justice, de démocratie… et d’efficacité.
Être vu, être entendu : une reconnaissance nécessaire
Depuis plusieurs années, le CNLE porte haut la parole des personnes en situation de pauvreté, non pas comme de simples bénéficiaires, mais comme des experts du vécu. La création en son sein du Collège des personnes concernées incarne cette volonté : il ne s’agit plus seulement de « parler pour », mais bien de « parler avec », voire « laisser parler ».
Dans un monde où les dispositifs sociaux se complexifient, où les discours publics peinent à atteindre celles et ceux qui en sont les premiers concernés, donner la parole devient un acte politique fort. Cette parole ne doit pas être instrumentalisée. Elle doit éclairer, interpeller, réorienter les politiques. Elle doit déranger parfois, mais surtout être écoutée jusqu’au bout.
Des politiques conçues sans les pauvres sont des politiques pauvres
Le CNLE le rappelle souvent : « rien sur nous sans nous ». Il ne suffit pas d’avoir un plan, une stratégie, une réforme du RSA. Si les premiers concernés ne sont pas associés à la conception des politiques de solidarité, celles-ci manquent leur cible.
Les invisibles — précaires, sans-abris, travailleurs pauvres, aidants familiaux, jeunes sans ressources — ont trop longtemps été objets de politique. Il est temps qu’ils deviennent sujets.
C’est tout le sens du Pacte des solidarités, dans lequel le CNLE joue un rôle de suivi et de veille. Ce pacte doit s’incarner sur les territoires, à travers les conférences régionales, les comités départementaux, les dispositifs de participation. Mais sans une écoute sincère, sans une capacité des institutions à se remettre en question, la promesse de participation reste lettre morte.
Rendre visible, c’est aussi protéger
L’invisibilité sociale est souvent une stratégie de survie : fuir les radars administratifs pour échapper aux contrôles, se taire pour ne pas perdre un maigre droit, éviter les institutions par peur d’être jugé.
Mais rendre visible, ce n’est pas dénoncer. Ce n’est pas pointer du doigt. C’est accueillir la parole là où elle se cache. C’est créer les conditions d’une confiance réciproque entre les invisibles et les institutions. Et cela demande du temps, de la présence, de la bienveillance.
Le CNLE doit être un guetteur de cette confiance, un vigile de la participation réelle. Il doit s’assurer que la visibilité ne soit pas une vitrine, mais une transformation. Il ne suffit pas d’inviter les personnes pauvres à une réunion : il faut leur donner le pouvoir de transformer la politique.
Les solidarités comme levier de transformation démocratique
La lutte contre les exclusions n’est pas qu’une affaire de budgets et de dispositifs. C’est une question de reconnaissance mutuelle. Une société se juge à sa capacité à faire place à chacun. Pas à intégrer dans un moule uniforme, mais à reconnaître la valeur de chaque trajectoire, de chaque vie cabossée.
Le CNLE, par sa composition pluraliste, son exigence de dialogue, sa mission de suivi des politiques publiques, est un espace rare. À condition qu’il ose faire remonter les voix dissonantes, qu’il donne le droit de citer aux oubliés, qu’il bouscule les cadres institutionnels trop normés.
De la visibilité à la dignité
Donner de la visibilité aux invisibles, ce n’est pas une opération de communication. C’est un combat pour la dignité. C’est reconnaître que la démocratie ne peut pas faire l’économie de ceux qu’elle laisse au bord du chemin.
Le CNLE doit être une caisse de résonance des solidarités vécues, pas seulement pensées. Un espace de plaidoyer et de transformation, à condition de garder le cap : ne jamais parler à la place, mais toujours à côté, avec, et parfois derrière, pour porter celles et ceux qui n’ont pas encore été vus.