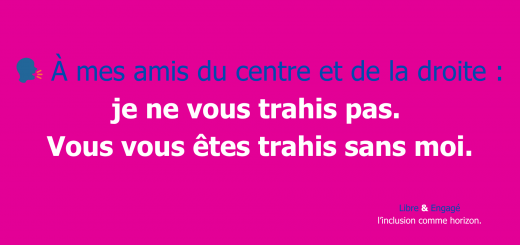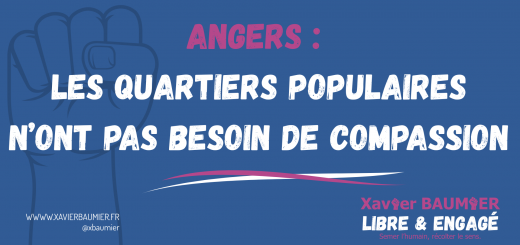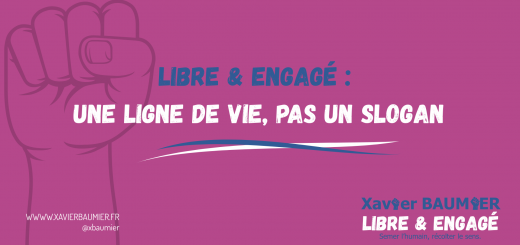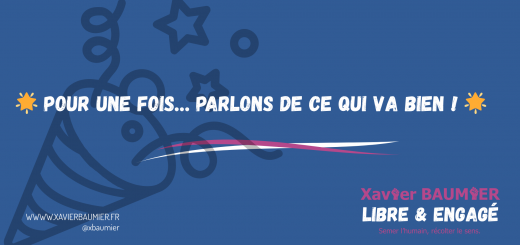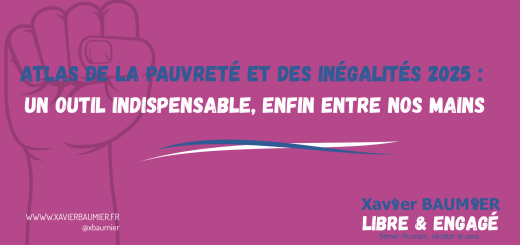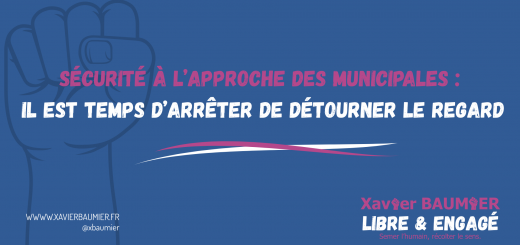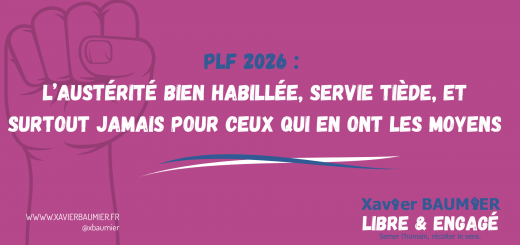Et si j’osais ne pas penser comme mon Église ?
On ne peut pas dire que les débats autour de la fin de vie et des soins palliatifs, en cours à l’Assemblée nationale, passionnent les foules. Il n’y a ni manifestations massives, ni polémiques virulentes, ni climat délétère comme pour d’autres sujets sociétaux. C’est même troublant : on aurait presque l’impression que ce projet de loi, qui ouvre la possibilité d’une aide à mourir dans un cadre très strict, fait consensus dans notre société. Assez rare pour être souligné.
Mais voilà. Une voix s’élève. Ou plutôt une institution, massive, d’un seul bloc : l’Église catholique de France. En tête, Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, qui s’est dit « profondément inquiet » de cette « rupture anthropologique majeure ». Il parle d’un « changement de civilisation ». Et derrière lui, la plupart des évêques prennent la parole à l’unisson. L’Église se lève, non pas au nom d’un dialogue, mais pour résister frontalement à un texte qui, pourtant, se veut humain, encadré, respectueux.
Et quand on les écoute, on a parfois l’impression que ceux qui soutiennent ce texte sont des apprentis sorciers ou, pire encore, des complices d’un « suicide assisté généralisé ». Comme si accompagner dignement la mort équivalait à abandonner l’humanité.
Mais la réalité du texte est bien différente. Il ne s’agit ni d’un droit ouvert à tous, ni d’une euthanasie à la demande. Le projet de loi soumis à l’Assemblée nationale prévoit des conditions très strictes : il faut être majeur, atteint d’une maladie incurable en phase avancée ou terminale, et ressentir une souffrance physique ou psychologique réfractaire aux traitements. La demande doit être formulée de manière libre, éclairée, et réitérée. Un avis médical collégial est nécessaire. Et le recours aux soins palliatifs est toujours favorisé. Ce n’est ni un abandon des malades, ni une réponse par défaut. C’est une ultime possibilité, face à l’impasse.
Alors oui, je comprends les inquiétudes de mon Église. Je comprends que cette loi peut heurter une certaine vision de la vie comme don sacré, inviolable, que seul Dieu peut reprendre. Mais en même temps, je m’interroge : ne devons-nous pas faire preuve, aussi, de charité chrétienne ? Ne devons-nous pas entendre la souffrance, la solitude, le désespoir de celles et ceux qui, épuisés par la maladie, les douleurs, les pertes de dignité, demandent simplement à partir en paix ?
Est-ce trahir l’Évangile que d’entendre ce cri et d’y répondre, non pas par une leçon de morale, mais par un acte d’écoute, de miséricorde, de compassion ?
Suis-je moins chrétien si je pense que tout le monde n’est pas appelé à vivre un Golgotha ? Que tout le monde n’a pas à revivre le martyr du Christ pour mériter une mort digne ? Peut-être que certains y voient une faute, moi j’y vois une fidélité à l’amour du prochain.
L’Église de France, dans cette affaire, parle d’une seule voix. Ou plutôt, ses évêques parlent d’une seule voix. Mais le peuple de Dieu, lui, est bien plus nuancé, j’en suis témoin. J’en ai discuté avec des amis catholiques de tous âges, pratiquants ou non, investis ou discrets, et je n’ai pas entendu une opposition franche. J’ai entendu des doutes, des hésitations, des questions, mais aussi beaucoup de compréhension envers ce que la loi essaie d’atteindre : la paix pour ceux qui n’ont plus d’autre horizon que la souffrance.
Mais dans notre Église, il vaut mieux ne pas trop le dire. Parce qu’ici, les débats ne sont pas toujours accueillis. Et ceux qui osent penser différemment sont vite marginalisés, parfois réduits au silence. Peut-être un jour excommuniés, qui sait.
Ce n’est pas la première fois que je me sens en désaccord profond avec l’Église institutionnelle. En 2012 déjà, lors du débat sur le mariage pour tous, j’avais ressenti la violence de certains discours. Je n’oublierai jamais ces mots d’un évêque affirmant que cette loi allait « détruire la famille et ouvrir la porte à la barbarie morale ». À l’époque, ma foi en avait vacillé. Je me suis senti trahi. J’étais catholique, mais je me demandais si mon Église m’aimait encore. Dieu, Lui, ne m’a jamais quitté.
Je le redis aujourd’hui avec la même sincérité : je ne suis pas en rupture avec ma foi, je reste fils de l’Église. Mais je demande qu’on entende aussi nos voix, celles des croyants qui pensent autrement, qui croient que la dignité ne se limite pas à l’interdiction de mourir, mais s’incarne aussi dans la liberté, la paix, l’accompagnement jusqu’au bout.
Si la loi est adoptée, j’espère qu’elle le sera dans la sérénité et le respect mutuel. Si elle est rejetée et soumise à un référendum, que ce débat se fasse sans anathèmes, sans insultes, sans peurs attisées. Que chacun puisse dire ce qu’il pense, sans être accusé de trahison ni de froideur.
Et je terminerai en disant ceci : l’Église parle d’une seule voix, mais elle est habitée par une multitude de consciences. Des prêtres, des laïcs, des soignants, des croyants qui osent dire qu’un accompagnement digne de la fin de vie peut être aussi une œuvre d’amour. Ils sont encore peu audibles, mais ils existent.
Être chrétien, c’est parfois porter une parole différente, dans l’écoute radicale de la souffrance de l’autre. C’est ce que je crois. C’est ce que je vis.