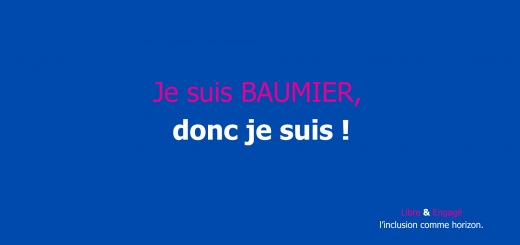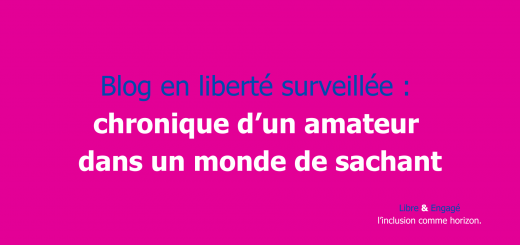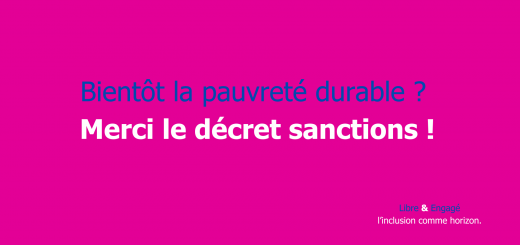Humaniste radical
Humaniste et radical : une boussole pour transformer vraiment
On me demande souvent : « Comment peux-tu être à la fois humaniste et radical ? »
Comme si l’un signifiait la douceur molle, et l’autre la brutalité inutile.
Cette opposition arrange bien ceux qui veulent maintenir l’ordre établi.
Pourtant, dans un pays où près de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, où les inégalités territoriales explosent, où la défiance envers l’action publique grandit, la réponse ne peut être ni la complaisance ni la violence.
L’engagement que je défends réconcilie ces deux forces : humaniste dans la fin, radical dans les moyens.
1️⃣ L’humanisme : la dignité comme ligne de force
L’humanisme repose sur un principe fondamental :
➡️ La valeur d’une personne ne dépend jamais de sa situation.
Ce principe a façonné nos droits sociaux :
- la Sécurité sociale qui protège chacun selon ses besoins,
- les droits fondamentaux inscrits dans le préambule de 1946,
- l’égalité de traitement comme norme républicaine.
Mais l’humanisme n’est pas qu’un héritage : il se vérifie dans les décisions publiques.
Quand on conditionne l’accès au RSA à des obligations supplémentaires,
Quand on multiplie les contrôles et sanctions,
Quand on soupçonne en premier lieu ceux qu’on devrait soutenir,
Alors l’humanisme recule.
En réalité, la pauvreté n’est pas un vice individuel :
c’est le produit d’événements de vie, de ruptures, de politiques, d’inégalités structurelles.
Personne ne choisit la précarité.
Être humaniste, c’est regarder un allocataire du RSA, non pas comme un coût, mais comme un citoyen.
Et accepter que l’accompagnement commence par la confiance, pas par le soupçon.
L’humain d’abord : non comme slogan, mais comme logique d’action.
2️⃣ La radicalité : aller à la racine des injustices
Radical ne veut pas dire extrémiste.
Radical vient de radix — la racine. 🌱
Être radical, c’est refuser les pansements politiques :
➡️ Une aide ponctuelle ne compense pas une organisation injuste.
➡️ Des discours compatissants ne réparent pas des mécanismes d’exclusion.
Par exemple :
Si l’on ne s’attaque pas au coût du logement, à l’accès aux soins, à la qualité des emplois,
alors toutes les réformes ne seront que des rustines.
Les grandes avancées sociales ont toujours été radicales :
📌 en 1945, instaurer la Sécurité Sociale paraissait fou
📌 en 1968, renforcer les droits des salariés était « dangereux »
📌 en 1988, créer le RMI était jugé « irresponsable »
Pourtant, ce sont ces ruptures qui ont amélioré la vie réelle.
La radicalité nous oblige à nommer les choses :
➡️ La pauvreté n’est pas un accident mais une construction sociale.
➡️ Les politiques publiques peuvent exclure autant qu’elles protègent.
➡️ Le droit peut être injuste s’il nie la réalité des vies.
Être radical, c’est refuser le mensonge du “tout va bien”.
C’est oser poser les vraies questions et accepter d’y répondre vraiment.
3️⃣ Séparer humanisme et radicalité : une double impasse
Quand on découple ces deux mots, tout se perd.
Sans humanisme
La radicalité devient une idéologie froide.
On sacrifie des personnes au nom d’un objectif supérieur.
Les erreurs deviennent des fautes.
Et l’on finit par imposer des solutions qui blessent ceux qu’elles prétendent servir.
La violence n’a jamais libéré durablement.
Sans radicalité
L’humanisme devient un vernis moral.
On compatit, on écoute, on accompagne… sans jamais changer la cause du problème.
La compassion se transforme en résignation :
« On fait ce qu’on peut… »
Mais faire ce qu’on peut n’est plus suffisant lorsque le système fabrique de la précarité.
4️⃣ Humaniste ET radical : la seule stratégie efficace
Ce choix, c’est celui d’une politique de la dignité active.
Une politique qui vise :
- la protection des personnes,
- la remise en cause des injustices,
- la transformation des institutions.
Cela implique d’agir avec les personnes concernées, pas à leur place.
Le savoir des plus pauvres est décisif pour construire des solutions justes.
➜ Sans participation, une politique perd son humanité.
➜ Sans transformation, une politique perd son utilité.
Cette articulation est une exigence démocratique :
Ceux qui vivent l’injustice doivent participer aux décisions qui les concernent.
5️⃣ Une position assumée dans mon engagement
Ce n’est pas une posture intellectuelle.
C’est une pratique quotidienne :
- Au sein du CNLE, où je refuse les discours qui culpabilisent les plus précaires.
- Sur le terrain, avec les associations qui protègent et émancipent.
- Dans les débats publics, même quand cela dérange les habitudes et les appareils.
On me dit parfois : « Tu es trop cash. »
Oui. Parce que la politesse institutionnelle peut devenir complice de l’injustice.
Je préfère déplaire plutôt que me taire.
Surtout quand il s’agit de dignité humaine.
Conclusion — La tendresse qui transforme
La société française se trouve à un croisement :
👉 soit la peur de l’autre nous divise,
👉 soit la dignité de chacun nous rassemble.
Je choisis la seconde voie.
Une voie exigeante, mais profondément humaine.
Humaniste dans le respect. Radical dans le changement.
Tendre dans les relations. Intransigeant sur les droits.
Parce que rien n’est plus violent que de laisser les injustices se perpétuer.
Et tant que la société ne respectera pas pleinement celles et ceux qu’elle fragilise,
je continuerai d’être humaniste et radical.
En acte. Et en parole.