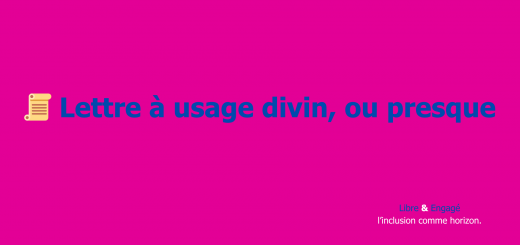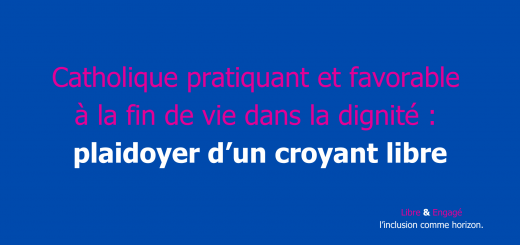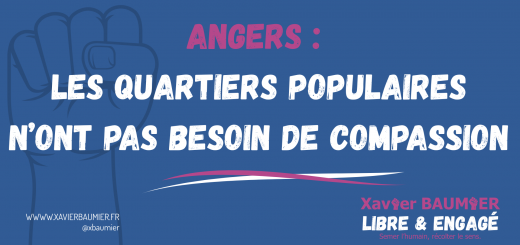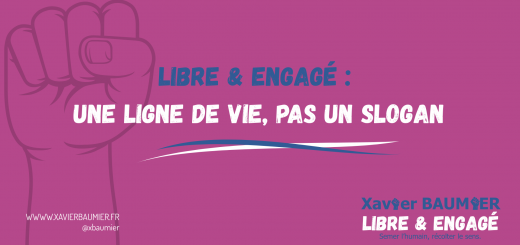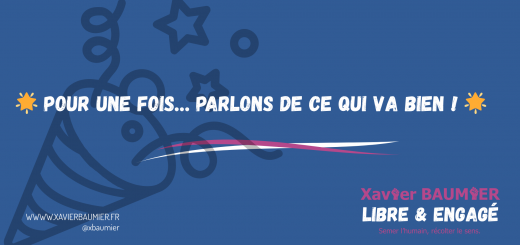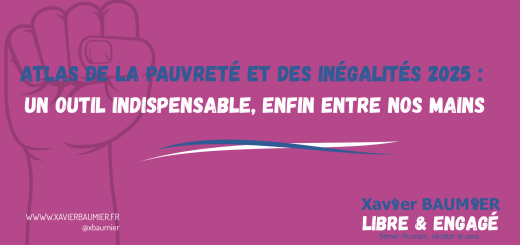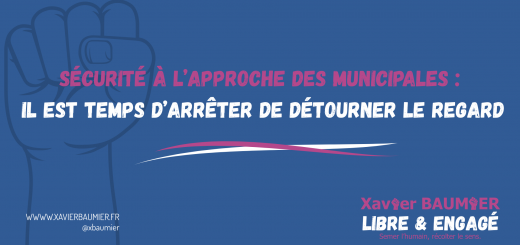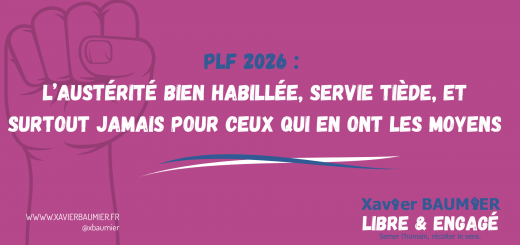Léon XIV : la prudence qui ressemble à un recul
par Xavier BAUMIER · Publié · Mis à jour
Depuis son élection, Léon XIV martèle la « continuité ». Sur le papier, rien de choquant. Dans les faits, cette continuité se traduit surtout par une mise sur pause des dossiers où François avait bousculé les lignes : place des femmes et accueil des personnes LGBT. Là où François avait ouvert des brèches pastorales et des chantiers d’étude, Léon XIV ferme les écoutilles doctrinales, au moins « pour l’instant ». C’est net dans sa première salve d’entretiens : on garde l’accueil, on ne touche pas à la doctrine – pas d’ordination de femmes, pas d’évolution sur le mariage, maintien d’un ton réservé.
Femmes : de l’élan réformateur au gel doctrinal
Sous François, deux mouvements concomitants donnaient le sentiment d’un écosystème qui bouge : d’un côté, des décisions concrètes (ouverture des ministères institués aux femmes, nominations féminines à des postes élevés) ; de l’autre, une exploration – commissions sur le diaconat féminin, synode laissant la question « ouverte ». Rien n’était décidé sur l’ordination, mais le processus respirait.
Léon XIV tranche autrement : « pas de grands changements ». Il dit ne pas envisager de modifier l’enseignement — ni sur le sacerdoce réservé aux hommes, ni, de facto, sur le diaconat féminin. Résultat : on passe d’un temps d’examen et d’attente (François) à un gel assumé (Léon XIV). Même si certaines nominations féminines peuvent se poursuivre, l’horizon sacramentel reste clos. Pour beaucoup, c’est un recul du rythme et de l’ambition.
Ce choix heurte un état de l’opinion catholique qui a bougé. Aux États-Unis comme en Amérique latine, une majorité de catholiques souhaite que les femmes puissent devenir prêtres ; le soutien a même fortement progressé depuis une décennie dans plusieurs pays. En France, les chiffres récents vont dans le même sens : 74 % des catholiques (et 76 % des pratiquants !) se disent favorables à l’ordination des femmes. Autrement dit : pendant que la base pousse, Rome freine.
Nuance utile : François lui-même a envoyé des signaux contradictoires (rappels de doctrine, prudences sur le diaconat), mais son méthode synodale laissait un espace réel au discernement. Là où François avançait par petits pas mais en avant, Léon XIV avance… en consolidation – donc latéralement. La perception de recul vient de là.
Personnes LGBT : accueil « continué », changement « ajourné »
François avait fait sauter un verrou pastoral avec Fiducia supplicans : possibilité de bénédictions non liturgiques pour des couples en situation « irrégulière » et pour des couples de même sexe, tout en distinguant clairement ces bénédictions du sacrement de mariage. L’esprit : accompagner sans confondre.
Léon XIV maintient l’accueil… mais verrouille l’interprétation : oui à la proximité pastorale, non à toute évolution doctrinale sur la sexualité et non à l’assimilation au mariage, défini homme-femme. Ici encore, on passe d’un François qui étire l’espace pastoral à un Léon XIV qui resserre les attentes : les bénédictions demeurent une tolérance encadrée, pas un tremplin vers autre chose. Pour beaucoup de fidèles, c’est un coup d’arrêt.
Or, l’opinion catholique, au moins en Occident, a fortement évolué : aux États-Unis, 70 % des catholiques soutiennent aujourd’hui le mariage civil entre personnes de même sexe. On peut débattre du périmètre sacramentel, mais la dissonance entre l’Église enseignante et ce que vivent/pensent bien des catholiques est flagrante – d’autant que des Églises locales (Allemagne, par ex.) ont déjà poussé vers des bénédictions de couples de même sexe.
Le vrai recul : le rythme et le cap
Si l’on réduit la comparaison aux textes, certains diront : « La doctrine n’a pas bougé sous François non plus ». C’est vrai – mais le cap n’était pas le même. François avait installé un processus : ouvrir des postes, créer des espaces de discernement, déplacer le curseur pastoral, accepter la conflictualité pour amorcer une réception. Léon XIV affiche une stratégie de stabilisation : on garde l’accueil, on défend la doctrine telle quelle, on évite les secousses. Les reculs sont donc moins des retours en arrière qu’un ralentissement assumé, vécu comme un coup de froid par ceux qui espéraient des franchissements supplémentaires.
Ce décalage est politiquement sensible : tant que la base catholique (notamment en Europe occidentale, en Amérique du Nord et dans une partie de l’Amérique latine) plébiscite davantage de place pour les femmes et une approche inclusive des personnes LGBT, chaque non-décision romaine élargit l’écart. À court terme, ce choix apaise une partie de la Curie et des épiscopats réticents ; à moyen terme, il fragilise la réception des orientations pastorales et creuse la distance avec des fidèles qui, eux, ont changé.
Et maintenant ?
Trois scénarios se dessinent en réalité. Le premier serait celui d’une consolidation durable : Léon XIV maintient sa ligne d’accueil sans réforme doctrinale, au risque de réduire Fiducia supplicans à une simple soupape et de fermer la porte aux attentes sur les femmes. Le deuxième passerait par un retour du local : des conférences épiscopales et des diocèses, notamment en Europe et en Amérique latine, continuent d’expérimenter des pratiques plus inclusives et de coresponsabilité, dessinant une géographie différenciée de l’Église que Rome tolère sans vraiment la cautionner. Le troisième, plus hypothétique aujourd’hui, verrait une reprise synodale : sous la pression de la base et des évolutions sociales, de nouveaux débats s’ouvriraient sur le diaconat féminin ou sur le langage doctrinal concernant la sexualité. Pour l’heure, Léon XIV semble préférer la première option : temporiser, geler, éviter les secousses, quitte à laisser s’approfondir le décalage entre la hiérarchie et les fidèles.
Verdict
Sur les femmes comme sur les personnes LGBT, Léon XIV ralentit la dynamique et resserre l’horizon par rapport à François. Le recul n’est pas une marche arrière spectaculaire ; c’est une stratégie de gel, qui laisse intactes des avancées pastorales ciblées mais bloque tout élargissement. Le fossé avec une majorité de catholiques — notamment en France, aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Amérique latine — se voit dans les chiffres. À force de gagner du temps, Rome pourrait bien perdre son monde.