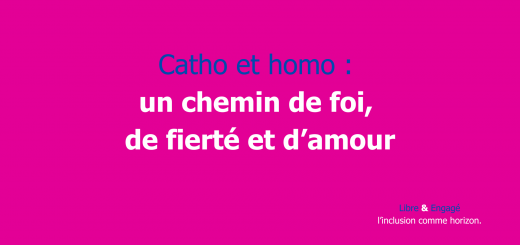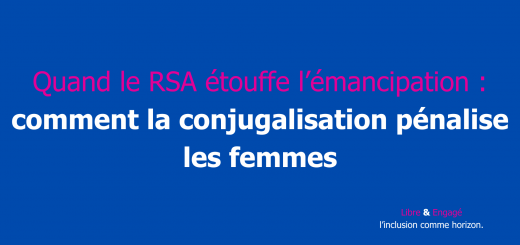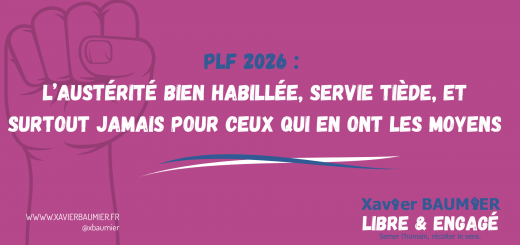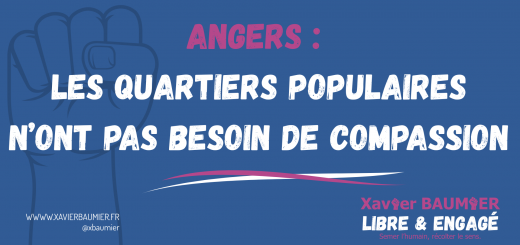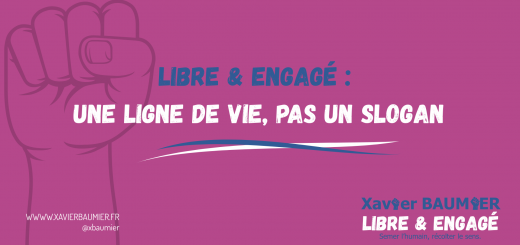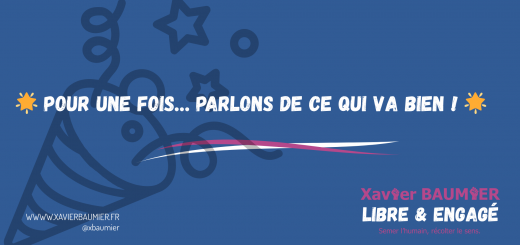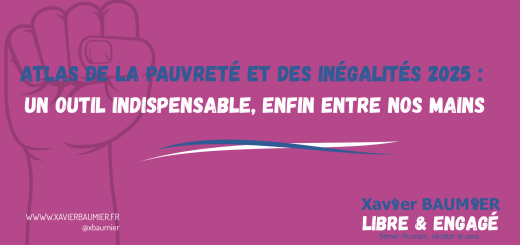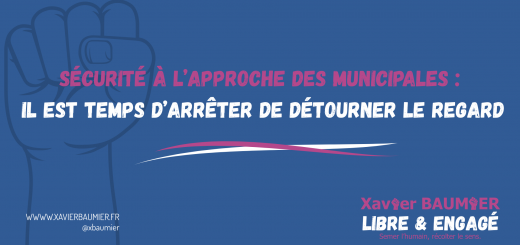Réforme des retraites : un simulacre de dialogue qui aggrave la crise sociale
La France est plongée dans une crise sociale profonde, ravivée par la volonté du gouvernement de durcir encore la dernière réforme des retraites. Malgré des mois de mobilisation populaire en 2023, l’exécutif persiste à passer en force, quitte à braquer une large partie de la population et des représentants sociaux. Pour tenter de rendre ce passage en force plus acceptable, le Premier ministre François Bayrou a convoqué fin février un « conclave » réunissant syndicats de salariés et organisations patronales, avec l’ambition affichée de retravailler la réforme en concertation – notamment sur le dossier explosif de l’âge de départ. L’initiative se voulait rassurante : « aucun totem ni tabou » ne serait exclu des discussions, promettait Bayrou.
Façade brisée. Très vite, le vernis de la concertation s’est craquelé. Dimanche dernier, coup de théâtre : le chef du gouvernement déclare publiquement son refus catégorique de revenir à un âge légal de 62 ans, pourtant au cœur des négociations. En clair, l’exécutif avait tranché la question avant même que les partenaires sociaux ne s’attablent. Cette annonce a fait l’effet d’une bombe, torpillant la crédibilité du conclave. Plusieurs participants ont aussitôt claqué la porte, rendant le processus caduc et mettant en lumière les contradictions du gouvernement.
Un conclave pour la forme
Lancé en grande pompe, le conclave sur les retraites s’est révélé n’être qu’un exercice de style sans substance. Officiellement, il s’agissait de « faire phosphorer » syndicats et patronat durant quelques semaines sur des ajustements de la réforme Bayrou. Officieusement, tout indique que l’affaire était entendue d’avance. En revenant sur sa promesse d’absence de tabou, le gouvernement a enterré la négociation avant même son terme. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a dénoncé une reculade inadmissible : le Premier ministre et le patronat ont, selon elle, « définitivement enterré ce conclave », trahissant l’engagement d’une discussion ouverte « sans totem, ni tabou ». Force ouvrière (FO) ne s’y était pas trompée : dès le départ, ce syndicat avait refusé de participer à une telle « mascarade », estimant qu’il n’y avait « rien à attendre » d’un pouvoir fermé à toute abrogation de la retraite à 64 ans. Symptomatiquement, même une organisation patronale comme l’Union des entreprises de proximité (U2P) a quitté le conclave, y voyant un « jeu de dupes »– mais pour des raisons opposées, car ces représentants des petites entreprises jugent qu’il faudra au contraire aller au-delà de 64 ans pour équilibrer le régime. Bref, ce simulacre de dialogue n’a convaincu personne et a réussi l’exploit de braquer tout le monde, des syndicats de salariés aux associations patronales.
Le gouvernement Bayrou apparaît ici en plein contresens. D’un côté, il affiche une volonté de concertation, et de l’autre il verrouille toute possibilité de compromis réel. Cette contradiction flagrante a mis fin à la « trêve » conclue avec une partie de l’opposition. Pour mémoire, la tenue de ce conclave était au départ une concession politique destinée à amadouer certains élus. En janvier, afin d’éviter une motion de censure au Parlement, le Premier ministre avait promis ce cycle de discussions aux socialistes, qui réclamaient l’abrogation pure et simple de la réforme adoptée sous Élisabeth Borne
. Ce marché de dupes a volé en éclats. « Que vaut la parole du Premier ministre ? », s’est indigné le chef du Parti socialiste Olivier Faure après le revirement gouvernemental. En rompant son engagement, Bayrou a non seulement humilié les syndicats, mais aussi trahi ceux qu’il avait cherché à convaincre. Le conclave n’était qu’un conclave pour la forme, une mise en scène dont plus personne n’est dupe.
Le mirage du dialogue social
L’épisode du conclave avorté illustre le mirage du dialogue social entretenu par le pouvoir en place. Depuis le début de ce bras de fer sur les retraites, le gouvernement clame son attachement à la concertation, tout en menant la réforme à sa guise contre vents et marées. En 2023, déjà, la réforme Borne avait été imposée sans vote à l’Assemblée grâce à l’article 49.3, malgré des manifestations historiques et une opinion publique massivement opposée. L’ensemble des syndicats français – du modéré CFDT au contestataire CGT – avaient formé un front uni, fait rare, pour réclamer le retrait du texte. Ignorant cette opposition quasi unanime, le gouvernement était passé en force, abîmant durablement la confiance entre les partenaires sociaux et l’exécutif.
Bayrou, en arrivant à Matignon, prétendait incarner un esprit de dialogue pour apaiser le pays. Or, en pratique, il reproduit la même méthode autoritaire. Le conclave qu’il a orchestré n’a été qu’une parenthèse illusoire : les principales décisions étaient déjà prises, et les syndicats invités à discuter du menu fretin. La colère n’en ressort que plus forte. « François Bayrou a rompu le contrat » de la concertation et « changé les règles du jeu », a fustigé Marylise Léon, la nouvelle secrétaire générale de la CFDT. Même la CFDT, pourtant disposée au compromis, se sent dupée. Pour elle, comme pour les autres organisations syndicales, le prétendu dialogue social promis par l’exécutif n’a été qu’une illusion, un simple écran de fumée destiné à gagner du temps et à tenter (sans succès) de désamorcer la contestation.
En agissant de la sorte, le gouvernement accentue la fracture avec les corps intermédiaires. Le dialogue social, pilier du modèle français où les grandes réformes s’élaborent généralement via la négociation, se trouve court-circuité. « Il ne voit pas où est le problème », s’indigne la CFDT à propos de Bayrou– cette cécité du pouvoir vis-à-vis du mécontentement populaire est en soi problématique. Car à force de fermer la porte au compromis, l’exécutif pousse les opposants à durcir leur mouvement ou à se retirer complètement des discussions. Dans les deux cas, le risque est un blocage durable : on l’a vu avec la grève reconductible des éboueurs, le blocage des raffineries ou encore les violences sporadiques en marge des cortèges. Le gouvernement, en s’obstinant ainsi, joue avec le feu social.
Les oubliés de la réforme
Au-delà de la méthode, le fond de la réforme concentre les injustices. Les sacrifices exigés se répartissent très inéquitablement dans la population, frappant de plein fouet les travailleurs les plus vulnérables. La réforme vise à repousser l’âge de départ à 64 ans et à allonger la durée de cotisation, sans véritablement corriger les inégalités initiales du système. Elle pénalisera les plus précaires et notamment les femmes dans sa forme actuelle. Celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui occupent des emplois pénibles ou ont des carrières hachées (souvent des femmes ayant élevé des enfants) seront les grands perdants. Par exemple, en allongeant la durée de cotisation, on augmente le nombre de personnes qui devront attendre 67 ans pour une retraite à taux plein – un scénario qui touchera surtout les travailleurs précaires aux carrières discontinues et les mères de famille
La statistique est glaçante : avec un âge légal porté à 64 ans, un tiers des hommes les plus pauvres seront déjà morts avant même de pouvoir toucher leur pension, alors que 94 % des hommes les plus riches sont encore en vie à cet âge
Aujourd’hui déjà, à 62 ans, un quart des hommes les plus modestes n’est plus de ce monde, contre seulement 6 % des plus aisés
Autrement dit, ce report de l’âge de départ « retire de la vie » aux plus pauvres
. Ceux-ci auront cotisé toute leur existence – souvent dans des métiers éreintants – pour financer les retraites de leurs aînés, sans jamais profiter de la leur. L’écart d’espérance de vie entre un ouvrier et un cadre atteint d’ailleurs 13 ans. Réclamer deux années de labeur supplémentaires à des ouvriers déjà usés jusqu’à la corde relève d’une violence sociale inouïe. À 35 ans, un cadre supérieur peut espérer vivre 34 années de plus en bonne santé, dix ans de plus qu’un ouvrier du même âge. Ces dix années sont précisément celles que le gouvernement entend retirer aux travailleurs les plus fatigués.
Les défenseurs de la réforme objecteront que travailler plus longtemps est nécessaire pour sauvegarder le système. Mais de quel travail parle-t-on ? Beaucoup de seniors n’ont déjà plus d’emploi avant même d’atteindre l’âge de la retraite. Seuls 38 % des 60-64 ans occupent aujourd’hui un emploi
les autres sont au chômage, en invalidité, en maladie de longue durée ou sortis du marché du travail. Repousser l’âge de la retraite dans ces conditions ne crée pas des emplois par magie : cela ne fait que prolonger la période pendant laquelle ces seniors vivent sans revenu d’activité, en attendant de pouvoir liquider leur pension. La DREES (organisme statistique du ministère de la Santé) estime qu’en France 1,4 million de personnes de 53 à 69 ans se trouvent déjà dans ce « sas de précarité », sans emploi ni retraite, majoritairement des femmes peu diplômées et en moins bonne santé. Le taux de pauvreté au sein de ce groupe dépasse 30 %. On sait aussi qu’avec la précédente réforme, qui a repoussé l’âge de 60 à 62 ans, 125 000 à 150 000 personnes supplémentaires ont dû prendre une pension d’invalidité entre 60 et 62 ans, fau te de pouvoir travailler jusqu’à la nouvelle borne, et environ 80 000 de plus ont dû solliciter les minima sociaux pour survivre. Autant de destins brisés ou fragilisés par deux années de trop. Reculer encore l’âge à 64 ans ne fera qu’accentuer ce phénomène d’exclusion et de déclassement pour les « oubliés » de la réforme : les plus faibles, ceux qu’une société digne devrait protéger en priorité.
Un avenir social sous tension
En persistant dans cette voie, le gouvernement ouvre la porte à un avenir social sous haute tension. Les conséquences politiques et sociales de ce passage en force sont potentiellement explosives. D’abord, le contrat social s’en trouve sapé : à quoi bon dialoguer ou manifester si, de toute façon, « on ne nous écoute pas » ? C’est le sentiment dangereux qui s’installe chez de nombreux citoyens. La cassure entre les gouvernants et le pays réel se creuse un peu plus. Une large frange de la population – salariés modestes, jeunes inquiets pour leur avenir, retraités solidaires – se sent méprisée et abandonnée par ceux qui prétendent agir « pour le bien commun ». Ce ressentiment nourrit une colère froide dont on ne mesure pas encore toutes les retombées. Il pourrait se traduire par de nouvelles mobilisations de masse, par des grèves dures dans des secteurs stratégiques, voire par une radicalisation du mouvement social. L’intersyndicale, malgré l’échec du conclave, demeure soudée et déterminée à obtenir un retour à 62 ans. De leur côté, de plus en plus de citoyens, y compris modérés, pourraient être tentés de se détourner des voies institutionnelles pour se faire entendre, faute de véritable dialogue. Le risque d’un embrasement persistant plane sur les mois à venir.
Ensuite, ce passage en force aura un coût politique pour les dirigeants actuels. En jouant ainsi la confrontation, François Bayrou et sa majorité prennent le pari dangereux que l’épuisement finira par gagner le camp adverse. Mais ils fournissent du même coup un terreau fertile à leurs opposants. À court terme, une nouvelle motion de censure n’est pas à exclure tant la confiance est rompue. À moyen terme, l’image d’un pouvoir sourd et inflexible profite aux extrêmes : certains, à droite comme à gauche, n’hésitent pas à se présenter en recours face à un « système » injuste et hors sol. Marine Le Pen, par exemple, entend capitaliser sur le rejet populaire de la réforme pour renforcer son assise. De même, la gauche radicale ne manquera pas de rappeler que seule une autre politique aurait pu éviter ce chaos. En somme, la déchirure sociale provoquée par la réforme des retraites risque de se muer en profonde fracture politique. Le sentiment d’injustice fiscale et sociale – car on demande aux plus modestes de se serrer la ceinture pendant que d’autres sont épargnés – peut durablement miner la cohésion nationale.
Justement, parlons-en des choix budgétaires. Le gouvernement justifie l’allongement de l’âge de travail par la nécessité de combler un déficit des caisses de retraites estimé à 12 milliards d’euros à horizon 2030. Or, ce déficit temporaire et maîtrisé (environ 0,5 % du PIB) n’est pas une fatalité : il résulte en partie de moindres recettes, et non d’une explosion incontrôlée des dépenses
. Combler 12 milliards en repoussant l’âge et en réduisant les prestations est un choix politique délibéré. De nombreuses alternatives existent pour financer les retraites sans faire porter tout l’effort sur les classes populaires. Par exemple, une taxe de 2 % sur la fortune des milliardaires français suffirait à couvrir le déficit annoncé. Mais cette piste a été ignorée, de même que d’autres mesures de justice fiscale. Au contraire, depuis plusieurs années, les gouvernements successifs ont multiplié les cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises. La suppression de l’ISF, l’instauration de la flat tax sur le capital ou la baisse des impôts de production ont amputé les recettes publiques de plus de 30 milliards d’euros par ansoit bien davantage que le prétendu « trou » des retraites. À cela s’ajoutent les dizaines de milliards qui échappent chaque année au budget via l’évasion fiscale
. Ce rappel est essentiel pour mesurer l’indécence du discours officiel. On impose des économies drastiques aux travailleurs et futurs retraités, tandis que l’on renonce à des recettes disponibles chez ceux qui en ont les moyens. Le résultat prévisible, c’est une aggravation des inégalités : les pauvres travailleront plus pour gagner moins, pendant que les plus riches continueront de voir leurs privilèges fiscaux préservés. Sur le plan social, cette politique à sens unique est explosive. Elle envoie le signal que la solidarité nationale ne s’exercera plus qu’à sens unique – toujours dans le même sens.
Dans ce contexte tendu, une vigilance citoyenne accrue s’impose. Il est crucial que les citoyens ne baissent pas les bras et continuent d’exiger des comptes à leurs dirigeants. Le débat démocratique doit reprendre ses droits : face à un pouvoir qui feint d’écouter pour mieux imposer ses vues, la société civile doit redoubler d’attention, de mobilisation et de créativité pour se faire entendre autrement. Ne laissons pas la résignation l’emporter. Chacun, à son échelle, peut relayer les faits, démonter les contrevérités budgétaires, soutenir les actions solidaires et rappeler les valeurs d’égalité qui fondent notre pacte social. L’enjeu dépasse la seule question des retraites : c’est la direction globale de notre modèle de société qui se joue. Allons-nous accepter sans mot dire un futur où les droits sociaux se réduisent comme peau de chagrin, où le dialogue social n’est plus qu’une façade, et où les inégalités se creusent ? La réponse dépend de notre engagement collectif, de notre capacité à faire vivre la démocratie au-delà des discours officiels.
En définitive, ce feuilleton de la réforme des retraites aura révélé bien des visages. Celui d’un pouvoir qui se disait centriste et ouvert, mais dont les pratiques brutales rappellent les heures les plus sourdes de la Ve République. Celui d’une société civile vibrante, capable d’un sursaut d’unité face à l’injustice, mais encore en quête de voies efficaces pour se faire respecter. Plus que jamais, l’issue de cette crise sociale dépendra de la pression citoyenne maintenue dans les semaines et mois à venir. Restons en alerte, informons-nous, échangeons, et n’hésitons pas à interpeller nos élus. C’est à ce prix que pourra être évitée une rupture irrémédiable entre le peuple et ses gouvernants. Et n’oublions pas : Bayrou se voulait rassembleur, il est au contraire le pire des diviseurs.