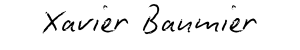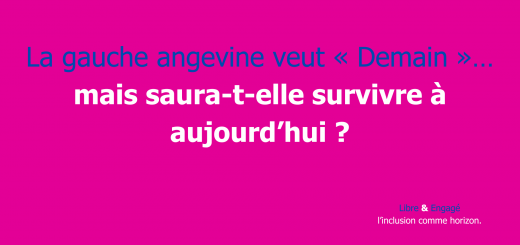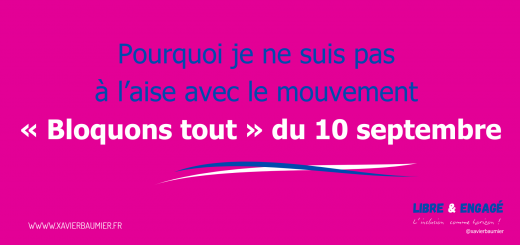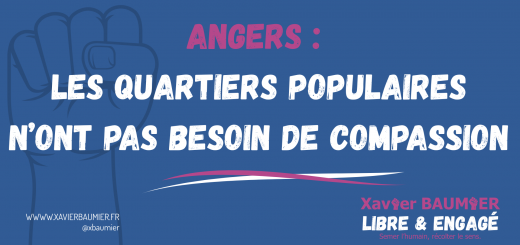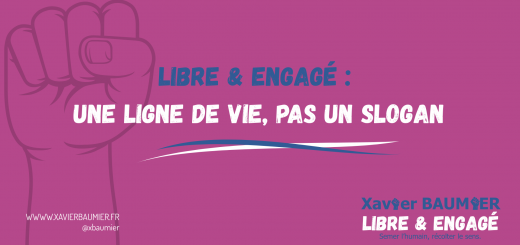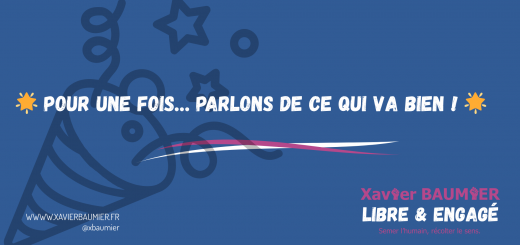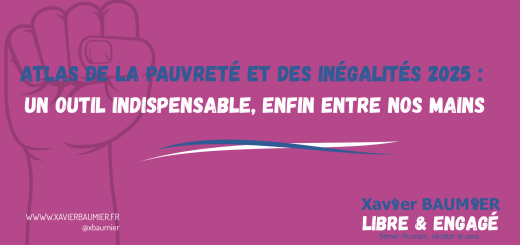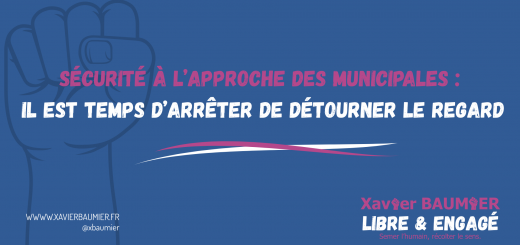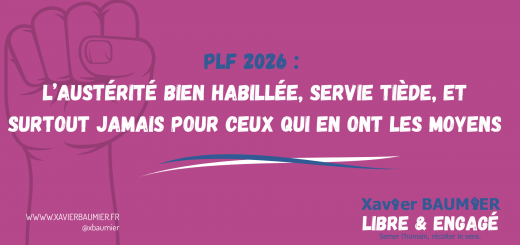RSA dans le Maine-et-Loire : gouverner, c’est appauvrir ?
par Xavier BAUMIER · Publié · Mis à jour
Une baisse massive… et inquiétante
Depuis plusieurs années, le nombre d’allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) diminue dans le département du Maine-et-Loire. En 2015, ils étaient plus de 20 000 à percevoir cette prestation. Fin 2021, ils étaient environ 17 000, et en octobre 2024, le chiffre est tombé à 13 630 allocataires. Une baisse de près de 35 % en moins de dix ans. Cette tendance, plus marquée que la moyenne nationale, pourrait être présentée comme un succès des politiques publiques. Mais elle soulève en réalité de profondes inquiétudes.
Le contexte économique local : un territoire sous pression
La situation économique du Maine-et-Loire elle-même est particulièrement fragile. Le département souffre d’une offre d’emploi insuffisante et très inégalement répartie sur le territoire, en particulier pour les personnes peu qualifiées ou en situation de vulnérabilité. Le tissu économique local ne permet pas, à lui seul, un retour massif à l’emploi. Dans ce contexte, les allocations sociales comme le RSA sont indispensables à la survie de milliers de familles. Sans elles, de nombreux foyers ne pourraient tout simplement pas vivre sur notre territoire.
Le non-recours : une réalité massive et invisible
Certes, le retour partiel à l’emploi explique une part de cette diminution. Le taux de chômage a baissé, des dispositifs locaux d’insertion ont été renforcés, et certains allocataires ont accédé à des emplois, souvent précaires. Mais ces raisons sont loin d’être suffisantes.
Depuis 2023, le nombre de personnes qui renoncent à demander le RSA augmente. La DREES estime que 34 % des personnes éligibles au RSA n’y recourent pas. Dans le Maine-et-Loire, le Secours catholique estime ce taux à 36 %, en augmentation de 10 points depuis 2010. Cela signifie qu’un tiers des personnes qui devraient percevoir le RSA dans le département ne le reçoivent pas. Dans les territoires où le RSA conditionné a été expérimenté, le Secours catholique a observé une progression de +10,8 % du non-recours en un an. C’est donc une partie invisible de la pauvreté qui s’étend, bien que les chiffres affichés diminuent.
Mais qu’est-ce que le non-recours exactement ?
Le non-recours désigne le fait qu’une personne remplissant les conditions pour bénéficier d’un droit (comme le RSA) ne le perçoive pas. Cela peut être dû à :
- Une méconnaissance du droit
- La complexité des démarches administratives
- Une peur des contrôles ou une stigmatisation sociale
- Une auto-censure, par honte ou sentiment de ne pas mériter
- Une fatigue face à la machine institutionnelle
Le non-recours est mesuré en comparant le nombre estimé de personnes éligibles à une prestation (grâce à des enquêtes statistiques comme celles de l’INSEE) au nombre réel de bénéficiaires (données CAF, MSA, etc.).
Taux de non-recours = (nombre de personnes éligibles – nombre de bénéficiaires) ÷ nombre de personnes éligibles
Ce phénomène est massif, invisible, et en constante progression. Il fausse la lecture des chiffres sociaux, en donnant l’illusion d’une amélioration de la situation.
Le rôle d’Angers et de ses élus : une solidarité en trompe-l’œil
On pourrait aussi s’interroger sur ce qu’a fait concrètement le maire d’Angers, Christophe Béchu, pour les solidarités dans sa propre commune. Ancien ministre de la Transition écologique, membre du gouvernement Borne, il a pourtant eu entre ses mains les outils et les leviers d’action. À Angers, pourtant, la pauvreté progresse, les demandes d’aides sociales explosent, et les publics précaires se multiplient dans les quartiers populaires. Que reste-t-il de l’ambition sociale d’une ville qui se veut modèle ?
Les allocataires du RSA ou de l’AAH à Angers sont confrontés aux mêmes écueils que partout ailleurs : non-recours, contrôles, numérisation des démarches, pression sociale. Le rôle d’une grande ville comme Angers devrait être d’amortir les chocs, de déployer des politiques inclusives. Mais rien de tel ne transparaît. La ville-centre semble davantage préoccupée par son attractivité que par le sort de ses plus fragiles. Il serait temps de reposer la question : à quoi sert une mairie si elle n’est pas le dernier rempart contre la précarité ?
Quand la politique nationale s’aligne sur la politique locale
Il faut aussi rappeler que les politiques sociales locales ne sont pas neutres, et qu’elles s’inscrivent dans un paysage politique cohérent avec la ligne gouvernementale. Le département de Maine-et-Loire est présidé par Florence Dabin, élue divers droite, proche des orientations libérales du pouvoir en place. Quant à la ville d’Angers, elle est dirigée par Christophe Béchu, ancien ministre de la Transition écologique sous le gouvernement Borne, et membre du parti Horizons d’Édouard Philippe. À travers leurs décisions, leur manière de mettre en œuvre la réforme du RSA, on retrouve la même logique de fermeté, de conditionnalité, et de réduction des dépenses sociales.
Le piège du « plein emploi »
On peut s’interroger : pourquoi le gouvernement fait-il du RSA un levier central de sa politique de « plein emploi » ? Est-ce qu’il faut à ce point faire baisser les chiffres du chômage en France, quitte à mélanger les registres et à stigmatiser des publics qui ne sont pas dans la même situation que les demandeurs d’emploi classiques ? Car enfin, le RSA est un filet de sécurité sociale, pas un outil de pilotage statistique.
Derrière cette stratégie, c’est tout un modèle social qui vacille. La France peut s’enorgueillir d’un système de solidarité qui garantit à chacun un minimum vital. Faut-il vraiment le sacrifier sur l’autel d’objectifs politiques ? Faut-il baisser artificiellement les chiffres du chômage en radiant les plus pauvres, plutôt qu’en les accompagnant ? Faut-il à ce point travestir les valeurs de la République ?
Car le gouvernement, en réalité, agit ainsi pour des raisons budgétaires et politiques : dans un contexte de forte tension des finances publiques, où il faut montrer à Bruxelles que les dépenses sociales sont sous contrôle, le RSA devient une variable d’ajustement. On présente cette logique comme de la responsabilisation, mais c’est surtout une stratégie de compression budgétaire.
Et cela arrive à un moment où les tensions sociales s’exacerbent : une partie des classes moyennes, qui travaillent, qui cotisent, qui paient leurs impôts, éprouve un sentiment de déclassement, de difficulté à joindre les deux bouts. Et dans ce climat inflammable, on désigne les plus pauvres comme boucs émissaires, présentés comme des profiteurs de l’argent public. Cela alimente les divisions, les jalousies sociales, et détruit ce qui faisait notre fierté collective : la solidarité nationale.
On ne vit pas de l’égalité sociale, on en survit. Et quand cette survie devient un enjeu politique, c’est toute notre démocratie qui s’en trouve fragilisée.
Un combat pour la dignité sociale
Depuis des semaines, je me bats au sein du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) pour que notre instance émette un avis clair sur ce décret dit « sanction-remobilisation », prévu pour entrer en application le 1er juin 2025. Ce texte, voulu par le gouvernement, autorisera une suspension de 30 % à 100 % de l’allocation RSA pendant trois mois, en cas de non-respect des obligations d’activité hebdomadaires. Il est établi que cette sanction peut être appliquée sans entretien préalable, sans discussion, sans recours humain, souvent à la tête du client.
Nous avons émis un avis demandant un moratoire sur ce texte. Un sursis. Une suspension. Ce n’est peut-être pas suffisant, mais c’est un premier pas. Il faut que le gouvernement recule, qu’il renonce à signer ce décret, qu’il entende les alertes. Qu’il comprenne que ce n’est pas de l’ordre de la gestion administrative, mais de la vie de gens réels, de leurs enfants, de leurs foyers, de leur dignité.
Et s’il devait être signé malgré tout, alors il faudra que la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, en assume pleinement la responsabilité. Ce sera à elle que l’histoire demandera des comptes, sur la misère sociale produite par ce texte, sur les foyers plongés dans l’angoisse, sur les solidarités détricotées à coups de décrets technocratiques.
Je le dis ici sans ambiguïté : je serai toujours aux côtés des allocataires diminués, abîmés, à bout de souffle, de celles et ceux qui n’en peuvent plus de galérer pour vivre, tout simplement. Le RSA n’est pas un privilège, c’est un élan de solidarité. Et cet élan, aujourd’hui, on tente de le casser.