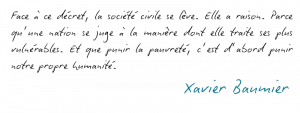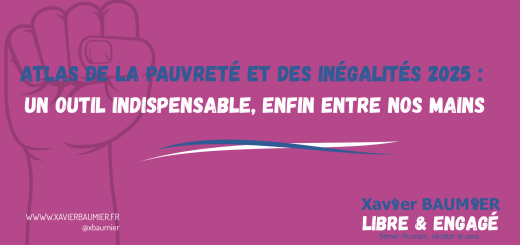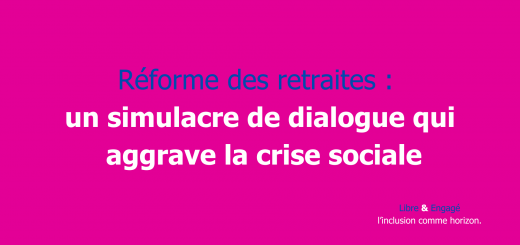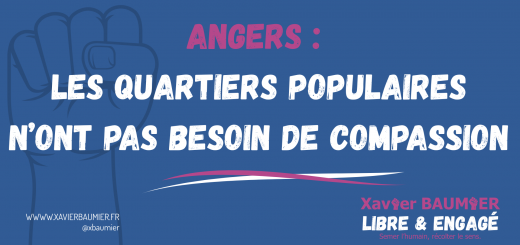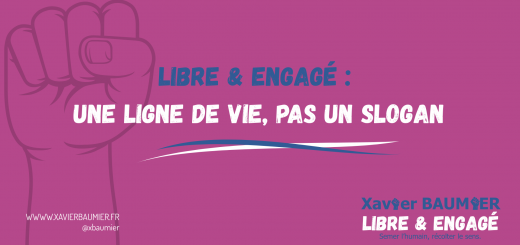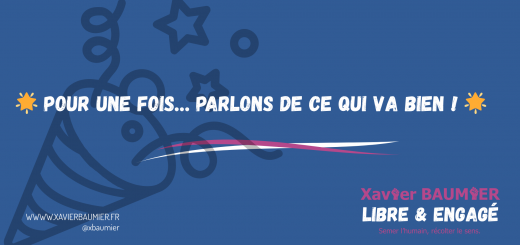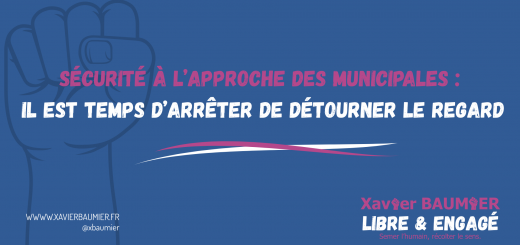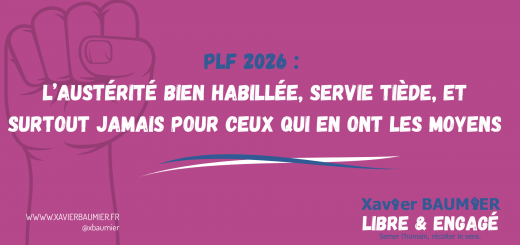RSA : le décret sanction ou l’art de punir les pauvres pour leur pauvreté
Bienvenue dans le monde merveilleux des politiques sociales à la française. Un monde où l’on prétend tendre la main en serrant le poing. Ce 1er juin 2025, un décret entrera en vigueur, instaurant un nouveau régime de sanctions pour les allocataires du Revenu de solidarité active (RSA). Officiellement, il s’agit d’un « levier d’insertion ». Dans les faits ? Une machine à broyer les plus précaires, dans un climat de méfiance généralisée où chaque allocataire est un suspect en puissance.
Un décret qui a fui dans la presse avant même d’être publié, dévoilant une philosophie bien connue : la précarité serait une faute morale. Une faute qu’il faudrait corriger par la menace, la suspension, la déshumanisation. On croyait cette vision rangée au rayon des vieilles idéologies. On se trompait lourdement. Le retour d’une vision naphtaline du social, où l’on agite le bâton en oubliant la main tendue.
Le texte du décret : un régime de sanctions à la tête du client
Le gouvernement a prévu un arsenal de sanctions allant de 30 % à 100 % de suspension de l’allocation RSA, déclenché en cas de « manquements » au contrat d’engagement signé avec France Travail. Pour les couples ou familles, la sanction est limitée à 50 %. En cas de répétition, l’allocation peut être supprimée totalement. La ministre Astrid Panosyan-Bouvet affirme que ces sanctions sont « progressives » et que les droits pourront être rétablis si l’allocataire se « remobilise ». Encore faut-il comprendre ce que « remobilisation » veut dire dans la bouche de ceux qui n’ont jamais connu une fin de mois difficile. Est-ce reprendre un stage non rémunéré ? Signer un contrat précaire ? Présenter un sourire en réunion de suivi ?
Un écran de fumée : responsabiliser ou culpabiliser ?
Derrière les mots feutres de l’administration, il y a une réalité brutale. Le gouvernement parle de responsabilisation. Mais pour responsabiliser, encore faut-il donner les moyens d’agir. Or, les dispositifs d’accompagnement sont dramatiquement sous-dotés, les agents surchargés, les formations inadaptées. Dans ce contexte, sanctionner relève plus du renoncement que de l’exigence. Ce n’est pas une main tendue : c’est une claque déguisée en conseil pédagogique. En réalité, on confond droits et privilèges, devoirs et soumission.
Ajoutons que les facteurs d’exclusion ne sont pas des choix personnels. La pauvreté, ce n’est pas un projet de vie. C’est le fruit de trajectoires brisées, de dérives institutionnelles, de politiques publiques parfois absurdes. En faisant peser la faute sur les individus, on invisibilise les défaillances collectives.
Les critiques sont massives, et justifiées
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) a rendu un avis défavorable. La CFDT est montée au créneau pour dénoncer une logique pénaliste. ATD Quart Monde parle d’une réforme indigne. Le Secours Catholique, Emmaüs, la Fondation pour le logement, les collectifs de personnes concernées… tous pointent l’absurdité de mesures qui, sous prétexte de réinsertion, plongent les gens dans une misère encore plus grande.
Et que dire des collectivités locales, qui devront appliquer ces sanctions sans moyens supplémentaires ? C’est un piège à ciel ouvert, où l’on transfère la violence de l’État vers les travailleurs sociaux, sommés de devenir des agents de contrôle.
Sur le terrain, les dégâts sont déjà visibles
Dans les départements tests, où cette logique de sanctions est déjà à l’œuvre, les effets sont dramatiques. Des personnes suspendues de leur RSA se retrouvent sans ressources, incapables de payer leur loyer, d’acheter à manger, de garder leurs enfants scolarisés. L’État les plonge dans la survie, puis leur reproche de ne pas être assez disponibles pour chercher un emploi.
Des associations rapportent des cas de familles entassées dans des logements insalubres, de jeunes adultes contraints de couper leur chauffage pour tenir le mois, de femmes seules renonçant à leurs soins de santé pour nourrir leurs enfants. Est-ce cela, la dignité à laquelle aspire notre République ?
Et pendant ce temps, les bugs administratifs se multiplient : des courriers non reçus, des convocations non transmises, des sanctions appliquées sans possibilité de réplique. L’État de droit s’efface devant la froideur algorithmique. Le droit au recours devient théorique, la parole des allocataires toujours suspecte.
Une autre voie est possible
Il est encore temps de renoncer à cette fuite en avant punitive. De faire confiance plutôt que de soupçonner. D’accompagner plutôt que de punir. Le RSA n’est pas un privilège, c’est un droit. Et les personnes qui en bénéficient ne sont pas des suspects par défaut. La société ne gagne rien à surveiller et punir ceux qui ont déjà tout perdu.
Il faut remettre du lien, de l’écoute, du temps. Investir dans l’humain. Créer des parcours d’insertion réels, pas des parcours de honte. Faire confiance aux personnes concernées, les associer aux politiques qui les touchent. Cela n’a rien d’utopique : c’est une question de volonté politique.
Face à ce décret, la société civile se lève. Elle a raison. Parce qu’une nation se juge à la manière dont elle traite ses plus vulnérables. Et que punir la pauvreté, c’est d’abord punir notre propre humanité.