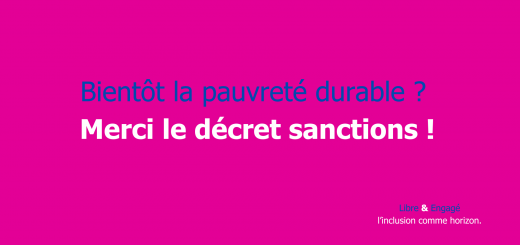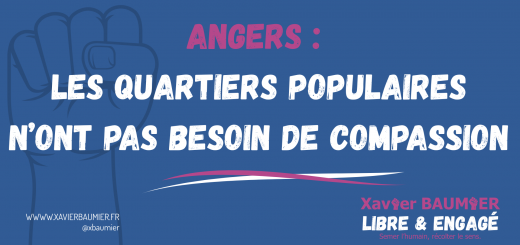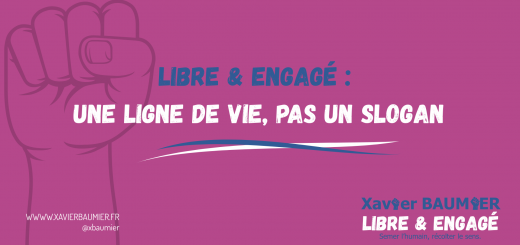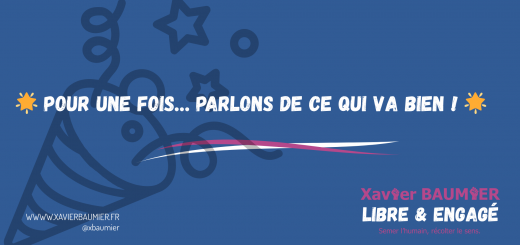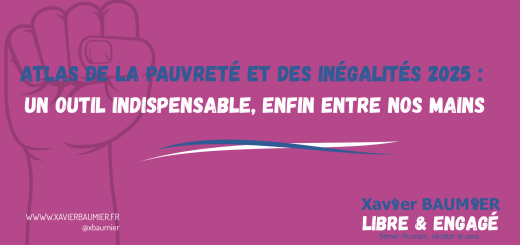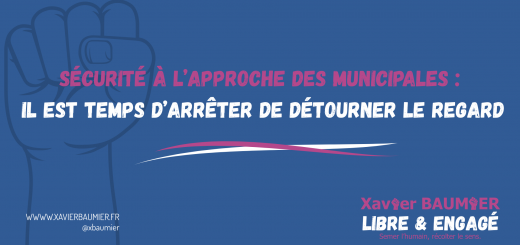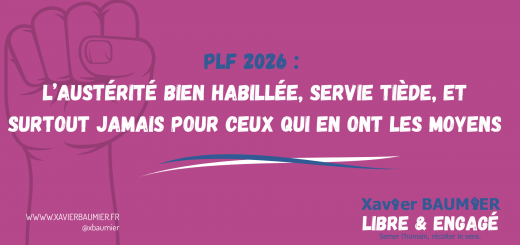Anne Rubinstein et la pauvreté : le choc des titres, le poids du vide
Il y a des moments où l’on se demande pourquoi certaines personnes prennent la parole. Il y en a d’autres où l’on se demande surtout pourquoi on les laisse continuer. Lors d’une formation interne, on nous a passé un extrait d’un discours d’Anne Rubinstein, enregistré lors d’une plénière du CNLE. Dix minutes d’intervention. Deux minutes d’attention. Et au bout de 120 secondes, le néant. J’ai lâché. Ce n’est pas que je sois incapable de concentration mais simplement parce que l’intervention de Mme Rubinstein était si brouillonne, si vaporeuse, qu’elle aurait pu servir de bande-son pour une séance de méditation transcendantale : des mots, sans prise, sans direction, sans queue ni tête. Et surtout sans respect pour les gens à qui elle s’adressait.
Mais qui est donc Anne Rubinstein ?
Anne Rubinstein n’est pas n’importe qui. C’est une haute fonctionnaire de l’État, inspectrice générale des affaires sociales (IGAS), ancienne directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Un parcours classique dans les sphères du pouvoir, qui mène en 2022 à sa nomination comme Déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Un titre qui claque. Mais plus ça claque, plus c’est flou. Et plus c’est flou… plus on rame.
Son rôle ? Officiellement, elle pilote la mise en œuvre de la politique gouvernementale de lutte contre la pauvreté. Concrètement, c’est plus compliqué. Elle gravite autour du ministère des Solidarités, sans être ministre, ni secrétaire d’État, ni même préfète. Elle plane dans la stratosphère administrative, là où les sigles s’accumulent et les décisions s’évanouissent.
Le CNLE : un lieu de dialogue… ou un théâtre d’ombres ?
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) est une instance consultative placée auprès du Premier ministre. Il réunit des représentants des administrations, des collectivités, des associations, des syndicats… mais aussi des personnes en situation de pauvreté, membres à part entière, avec voix délibérative. C’est l’un des rares lieux où les premiers concernés par les politiques publiques peuvent s’exprimer au même titre que les experts et les hauts fonctionnaires. Autant dire un espace rare, précieux… et fragile.
Et c’est précisément pour cela que les interventions creuses y sont d’autant plus insupportables. Quand une représentante de l’État s’y exprime sans contenu clair, sans capacité d’écoute, en usant de langue de bois, ce n’est pas seulement gênant. C’est insultant.
Le Pacte des solidarités : beaucoup de promesses, peu de concret
Madame Rubinstein est venue nous parler de la mise en œuvre du Pacte des solidarités. Ah, le Pacte… ce machin lancé en 2023 pour succéder à la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Vendu comme un renouveau. En vérité, un recyclage.
Le Pacte se veut ambitieux, structuré autour de quatre axes :
- La prévention de la pauvreté, notamment chez les jeunes et les enfants.
- L’accès aux droits (on ne précise pas si c’est avec ou sans rendez-vous à 8h42 sur CAF.fr).
- L’émancipation par l’emploi et la formation (encore faut-il qu’ils existent).
- La lutte contre la grande exclusion, avec un accent mis sur les personnes à la rue et sans domicile.
À l’origine, ce Pacte est porté par la ministre Aurore Bergé, qui multiplie les annonces médiatiques et les réunions consultatives. Mais dans la réalité de terrain, les associations attendent toujours les moyens, les lignes directrices claires, les marges de manœuvre. Et surtout : les décisions coconstruites avec les personnes concernées.
C’est là que le bât blesse : Anne Rubinstein nous parle « horizontalité », « dialogue », « écoute »… mais dans les faits, c’est du pilotage vertical, centralisé, et totalement hors-sol.
Le plaidoyer façon Rubinstein : quand le mot est joli, mais le fond bancal
Dans son intervention, elle nous explique aussi que son rôle est de faire des « plaidoyers ». Oui, des plaidoyers. Un mot qui fait bien en réunion. Problème : dans le secteur associatif, et particulièrement chez ATD Quart Monde, un plaidoyer, ce n’est pas juste faire un joli discours pour le cabinet du ministre. C’est une démarche politique, construite avec les personnes en situation de pauvreté, fondée sur l’expérience vécue, sur la parole recueillie, sur des faits.
Faire un plaidoyer, ce n’est pas porter une parole floue au nom d’autrui. C’est défendre un message collectivement construit. Ici, ce n’était pas un plaidoyer. C’était une tentative d’enfumage.
Quand l’autorité rime avec autoritarisme… ou confusion
Ce n’est pas la première fois que Rubinstein nous laisse sur notre faim. Lors d’un groupe de travail Participation II, elle était venue parler – de quoi, personne ne le sait. Ce qui est sûr, c’est qu’elle s’était présentée comme « la pilote » d’une équipe de commissaires à la lutte contre la pauvreté.
Petite précision : les commissaires à la pauvreté sont des hauts fonctionnaires déployés en région pour suivre et coordonner la mise en œuvre des politiques sociales locales. Ils dépendent de plusieurs ministères, pas de la déléguée interministérielle. Et lorsqu’on discute avec eux, on comprend rapidement que l’autorité d’Anne Rubinstein sur eux est… disons, plus symbolique que réelle. C’est un peu comme si elle avait hérité d’un volant de Formule 1, mais sans les pédales.
Mars 2025 : la phrase de trop
Et puis il y a eu cette fameuse plénière du CNLE en mars dernier. Moment lunaire. Alors qu’était présenté le rapport d’ATD Quart Monde sur la maltraitance institutionnelle – un travail de fond, documenté, poignant – Mme Rubinstein a osé affirmer que « la maltraitance institutionnelle n’existe pas ». Comme si on venait dire que la pluie ne mouille pas. Heureusement, le sociologue Jean-Claude Barbier, expert reconnu des politiques sociales, professeur émérite au CNRS, membre respecté du CNLE, l’a sèchement reprise. Et de manière magistrale.
Une remise en place salutaire. Car nier l’existence d’un phénomène que vivent des milliers de personnes, c’est non seulement une faute politique, c’est une maltraitance… verbale.
À quoi sert-elle ? Bonne question.
Je vais peut-être en choquer certains, notamment parmi mes collègues du CNLE. Mais à quoi sert cette dame ? À quoi sert une déléguée qui ne pilote rien, qui ne porte aucun message lisible, qui ne comprend pas les enjeux du terrain, qui nie les réalités les plus douloureuses – et qui semble avoir été recasée là, après une belle carrière au service d’un appareil d’État plus préoccupé par sa propre reproduction que par la réduction des inégalités ?
Un beau titre, des fonctions brillantes sur le papier, un discours sans consistance. Une présence institutionnelle qui rassure les ministères… et désespère les associations.
Et pendant ce temps, dans les accueils de jour, les épiceries sociales, les hôtels sociaux, les associations d’accès aux droits, on continue de ramer. Sans le confort d’un discours creux, mais avec la vérité rugueuse du terrain.