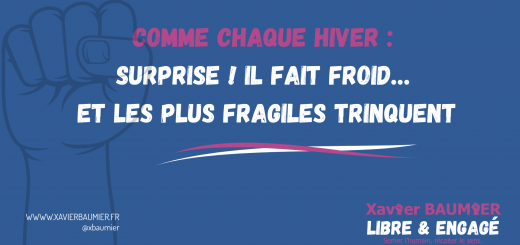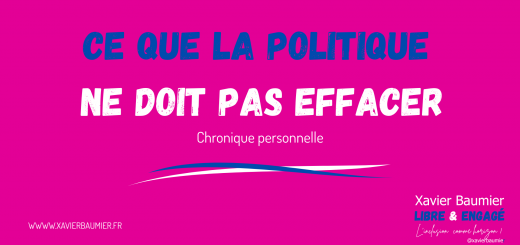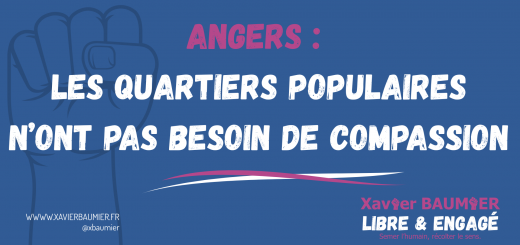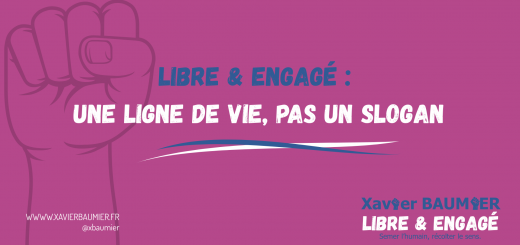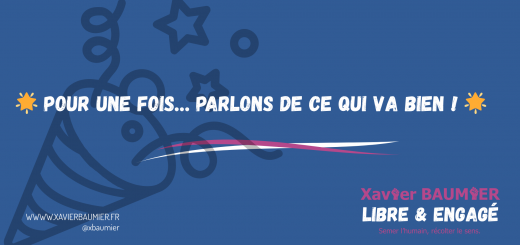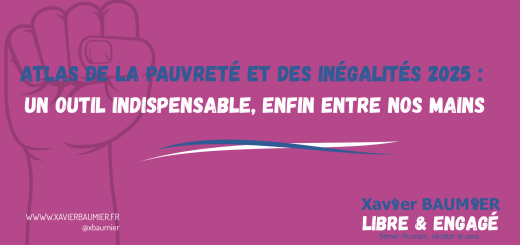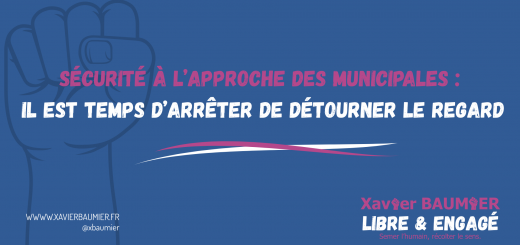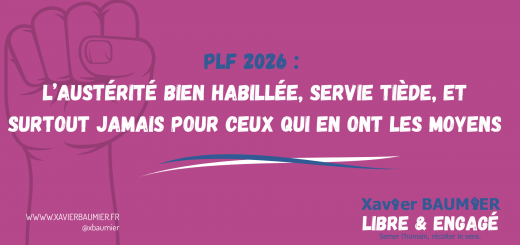S’engager en 2025 : sport de combat ou art de vivre ?
Il paraît que s’engager, c’est tendance. On en parle partout : sur les réseaux sociaux, dans les discours politiques, dans les écoles de commerce qui créent des « parcours engagement citoyen » entre deux cours de management agile. Même les influenceurs s’y mettent :
“Si toi aussi tu veux sauver la planète, like ma vidéo, entre ton code promo et plante un arbre à 15% de réduction.”
Bref, l’engagement est devenu bankable.
Et probablement bientôt sponsorisé par une marque de yaourts bio.
Mais entre le cynisme ambiant, la fatigue générale, et l’impression qu’on a déjà tout essayé pour pas grand-chose… c’est quoi, s’engager, aujourd’hui ?
Et à quoi ça sert, franchement ?
Spoiler : pas à sauver le monde tout seul.
Mais peut-être, un peu, à rester humain ensemble. Ce qui, ces temps-ci, relève déjà de la performance artistique.
S’engager, c’est pas gagner Koh-Lanta
Première mise au point : s’engager, ce n’est pas un concours de sacrifices ni un reality show.
Vous ne gagnez pas de collier d’immunité. Vous ne partez pas sur une île. (À moins que ce soit une AG en visio depuis Noirmoutier, mais ça compte pas.)
Vous restez ici, dans ce monde pas très bien rangé, avec ses files d’attente à la CAF, ses voisins fatigués, ses SDF qu’on évite du regard et ses politiques qui parlent de “valeurs” en faisant le contraire — parfois dans la même phrase, chapeau l’artiste.
S’engager, en 2025, c’est donc d’abord un acte de résistance douce. Une manière de dire :
« Non, je ne vais pas tout laisser pourrir sans rien faire. Non, je ne vais pas me contenter de râler sur X ou autour d’un apéro. »
C’est passer du mode “spectateur accablé” au mode “acteur un peu paumé mais volontaire”.
Et c’est déjà énorme.
Surtout si vous êtes encore capable d’écouter un débat politique sans lancer un objet contre la télé.
Pourquoi on s’engage ? Pour changer le monde ? Soyons sérieux.
On a tous commencé comme ça. Plein d’espoir, le poing levé, la playlist militante dans les oreilles.
On voulait changer le monde, secouer le système, abolir les injustices.
Puis on a découvert les réunions associatives. Les AG sans fin. Les comptes-rendus sur Google Docs.
Et les budgets à 12,40 €. Pas de quoi révolutionner l’ordre établi, mais on peut au moins s’acheter du café (à condition qu’il soit en promotion).
Et là, on a compris : s’engager, c’est pas glamour.
C’est pas révolutionnaire tout de suite. C’est un boulot de fourmi. Une fourmi insomniaque, sous-caféinée, mais tenace.
Mais c’est justement ça, la beauté du truc.
Parce que s’engager, ce n’est pas faire une grande chose une fois, c’est faire plein de petites choses tout le temps.
Et surtout, les faire avec d’autres. Être là. Tenir bon. Rester fidèle à une cause, à des gens, à une idée qu’on refuse d’abandonner.
C’est comme l’amour : ça ne marche pas si on n’y met pas un peu de sueur, beaucoup de patience, et un stock de biscuits pour tenir les réunions.
Politique, associatif : arrêtons de choisir, faisons les deux (ou au moins un)
Certains disent : “Moi je suis dans le concret, je fais de l’associatif.”
D’autres répliquent : “Moi je veux changer les lois, je fais de la politique.”
Très bien. Mais on peut peut-être se parler, non ?
Parce que pendant que les uns distribuent des repas, les autres votent des budgets.
Et si on ne fait pas le lien entre les deux… eh bien on tourne en rond. Un rond administratif, avec beaucoup de paperasse et très peu de café.
Et les gens en galère, eux, ils ont besoin des deux.
L’associatif répare, le politique structure. L’un panse les plaies, l’autre devrait éviter qu’on se blesse.
Mais entre les deux, souvent, un gouffre. Des murs d’incompréhension. Ou parfois pire : du mépris mutuel, façon “Mon terrain est plus noble que ton bureau”.
S’engager en 2025, c’est peut-être aussi ça : recoudre ce tissu déchiré entre les acteurs du terrain et ceux des institutions.
Faire passerelles. Travailler ensemble, même quand on n’est pas d’accord.
Spoiler : c’est pas facile.
Mais si on attend que tout le monde s’aime avant d’agir, on va attendre longtemps. Très longtemps. Genre, le retour du service public à guichet unique.
Et l’utilité, dans tout ça ?
C’est LA question.
« Ok, je m’engage… mais est-ce que ça sert à quelque chose ? »
Franchement ? Parfois, on ne sait pas.
On passe des soirées à faire du soutien scolaire, et le gamin finit par décrocher.
On se bat pour un hébergement d’urgence, et la personne est remise à la rue trois semaines après.
On rédige un rapport pour une réforme sociale, et il finit dans un tiroir, coincé entre le rapport sur la biodiversité et un vieux trombone.
Oui, il y a des échecs. Des coups de mou. Des envies de tout lâcher et d’aller élever des chèvres. (Ou des chats. C’est moins fatigant.)
Mais il y a aussi…
Un regard qui change. Une injustice évitée. Une personne qui retrouve confiance.
Et surtout, il y a cette certitude : ne pas avoir été complice.
Ni par le silence, ni par l’inaction.
Être utile, ce n’est pas “gagner”.
C’est se rendre disponible à la vie des autres.
C’est dire à ceux qui galèrent : “Tu n’es pas seul.”
Et à ceux qui détiennent le pouvoir : “On vous regarde, on vous interpelle, on ne vous lâchera pas.”
S’engager, c’est humain. Juste humain.
Pas besoin d’être un saint.
Ni parfait, ni exemplaire, ni végane, ni à jour de son tri sélectif. (Même si ça peut aider à la crédibilité.)
S’engager, ce n’est pas une identité, c’est un mouvement. Un chemin.
C’est rater, apprendre, recommencer.
C’est râler contre le monde, puis s’y remettre quand même.
C’est s’indigner ET faire la vaisselle de la dernière AG. (Ce qui demande un courage que peu soupçonnent.)
En 2025, face au repli, au repli du repli, et au repli du repli sur soi,
s’engager, c’est peut-être ce qu’il nous reste de plus beau.
Pas pour sauver le monde.
Mais pour ne pas le laisser tomber.
.