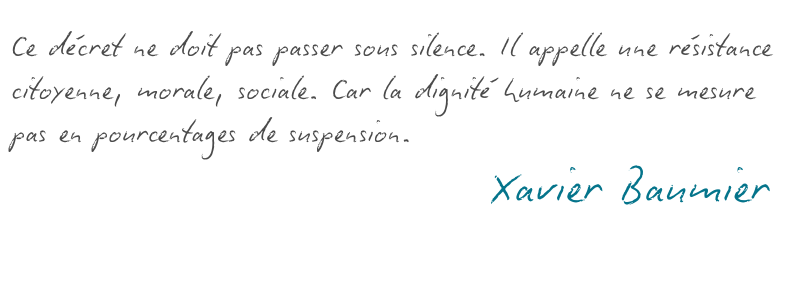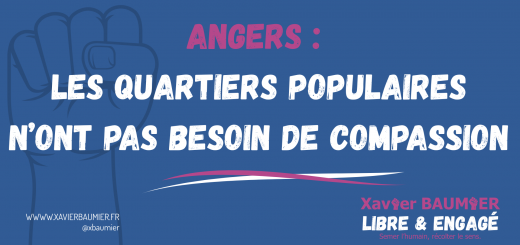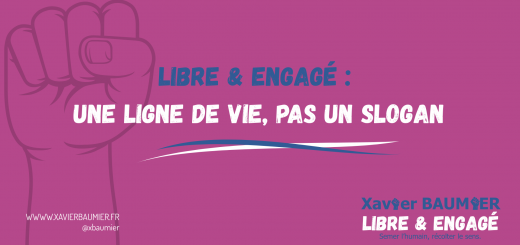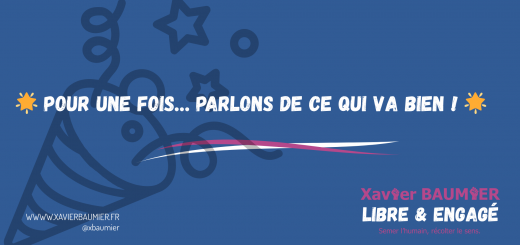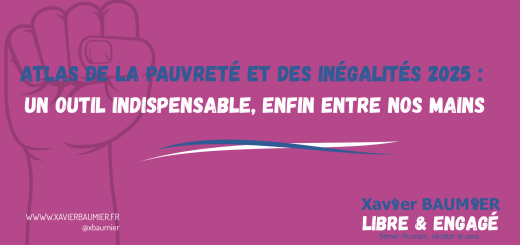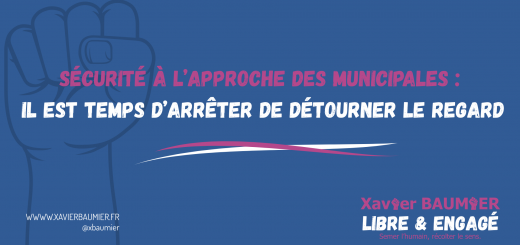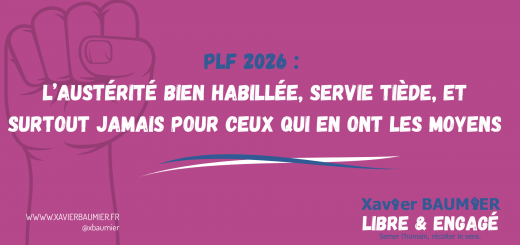Tribune : Le RSA sous condition, ou l’art de punir la pauvreté
Alors que le gouvernement déploie sa politique dite « du plein emploi », le nouveau décret relatif aux droits et obligations des demandeurs d’emploi marque un tournant répressif. Derrière l’habillage technocratique se cache une mesure qui, sous prétexte d’insertion, organise la stigmatisation et la punition des plus précaires.
Ce que je vois depuis mon engagement de terrain
J’écris cette tribune non comme expert ou observateur distant, mais en tant qu’acteur engagé depuis des années dans la lutte contre les exclusions, aux côtés des personnes en situation de pauvreté. J’ai grandi à la Roseraie, un quartier populaire d’Angers. J’ai appris dans la Jeunesse ouvrière chrétienne que la dignité humaine ne se négocie pas. J’ai été élu, militant, paroissien engagé, et aujourd’hui encore, je poursuis cet engagement au service des plus vulnérables.
Ce que je lis dans ce décret, ce n’est pas une politique sociale. C’est un mécanisme froid, technocratique, déconnecté des réalités humaines.
Un texte passé inaperçu mais lourd de conséquences
Le décret NOR : TSSD2508895D, publié en application de la loi « plein emploi » du 18 décembre 2023, bouleverse le cadre des droits sociaux liés au RSA et au statut de demandeur d’emploi. Il institue un régime de sanctions systématisées, codifiées, encadrées, déclinées selon des scénarios types. Mais ces sanctions, aussi rationnalisées soient-elles, visent un seul groupe : les plus pauvres.
Le contrat d’engagement : outil d’accompagnement ou chaîne de contrainte ?
Depuis des années, la logique du « droits et devoirs » irrigue la pensée sociale. Avec ce décret, le « devoir » prend le dessus. Le contrat d’engagement devient obligatoire pour tous les allocataires, remplaçant les anciens dispositifs comme le PPAE. Il fixe des obligations : rendez-vous, actions, démarches, et surtout « actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi ». La formule est vague, et c’est justement le danger.
En cas de manquement, même ponctuel, même pour cause de santé ou de difficulté familiale, les sanctions tombent : suspension de 30 à 100 % des aides, sur une durée allant jusqu’à quatre mois. La récidive ou la persistance entraîne la radiation, c’est-à-dire l’effacement pur et simple du droit. Sans recours réel, sans considération pour la complexité des parcours de vie.
Une gestion déléguée, une responsabilité éclatée
Le décret déploie une architecture administrative dense : les sanctions peuvent être prononcées par France Travail, les missions locales, les conseils départementaux ou la CAF, selon les situations. Dans certains territoires, les compétences sont recentralisées ou transférées, ce qui multiplie les interfaces et affaiblit la lisibilité pour les personnes concernées.
En déléguant ainsi la responsabilité, le décret installe un système où la sanction devient banale, presque automatique. Le lien d’accompagnement est rompu. Les agents sont sommés d’être à la fois accompagnateurs, évaluateurs, et parfois mêmes juges d’exécution. Une contradiction éthique majeure.
Le RSA transformé en levier de contrôle social
Ce que révèle ce décret, c’est un changement de paradigme. Le RSA, pensé en 2009 comme un droit inconditionnel à un minimum vital, devient une aide conditionnée, suspendue à la bonne volonté de l’allocataire telle que perçue par l’institution. Il ne s’agit plus de compenser une absence de ressources, mais de vérifier une activité constante, une posture de recherche, une preuve de mérite.
En somme, les plus pauvres doivent mériter leur pauvreté.
Une stigmatisation officielle des exclus
Le texte acte la suspicion permanente : en cas de deux refus d’une offre d’emploi jugée « raisonnable », la sanction tombe. Mais qu’est-ce qu’une offre raisonnable pour une mère isolée sans moyen de garde ? Pour un homme de 60 ans usé par les petits boulots ? Pour une personne en dépression qui n’ose plus franchir le seuil d’un bureau ?
Le décret ne prévoit pas de véritable évaluation qualitative. Il pose des seuils, des durées, des pourcentages. Il transforme des parcours de vie chaotiques en lignes de code d’un système d’information. Et surtout, il rend suspect tout allocataire, sans exception.
Des conséquences humaines dévastatrices
Suspendre ou supprimer le RSA, c’est priver une famille de ressources pour se loger, se nourrir, se chauffer. C’est provoquer des détentions de loyer, des expulsions, des ruptures sociales. Et le faire au nom de l’insertion relève de la perversion morale : comment retrouver un emploi si l’on a faim, si l’on dort dehors, si l’on perd confiance en soi ?
La pauvreté n’est pas un choix. C’est le fruit d’inégalités structurelles, d’accidents de la vie, de déclassements successifs. Prétendre l’éradiquer par la contrainte, c’est confondre la cause et la conséquence. C’est faire porter aux individus la responsabilité de la défaillance systémique.
Une vision de la solidarité dévoyée
Ce décret incarne une vision utilitariste de la solidarité : on aide, mais seulement si ça rapporte. On soutient, mais à condition que ça rentre dans des cases. On accorde des droits, mais suspendus à des obligations toujours plus nombreuses.
Or la solidarité, en république, est un pilier. Elle suppose l’inconditionnalité, la confiance, le respect. Elle reconnaît la dignité de chacun, même sans activité, même sans productivité.
Les contre-arguments du terrain : un rejet unanime
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), instance où j’ai moi-même l’honneur de siéger, a exprimé de fortes réserves. Nous avons alerté sur les effets délétères d’un dispositif qui repose sur la menace et non sur la relation de confiance. L’efficacité des politiques d’insertion repose sur l’écoute, la stabilité et l’accompagnement global, et non sur la sanction.
Les syndicats de travailleurs sociaux, tels que la CGT ou la CFDT, dénoncent une mesure qui va à l’encontre de leur mission première : aider, et non contrôler. Ils pointent le risque d’une administration saturée de procédures disciplinaires au détriment du temps d’accompagnement humain. Pour eux, cette politique transforme les professionnels en agents de tri social.
De nombreuses associations, comme ATD Quart Monde, le Secours Catholique ou la Fédération des acteurs de la solidarité, se sont élevées contre ce décret. Elles rappellent qu’une partie significative des personnes allocataires du RSA cumulent des freins massifs à l’emploi (santé, logement, alphabétisation, violences, isolement), et qu’un traitement égalitaire devant les sanctions est en réalité profondément inégalitaire. Elles dénoncent une logique de dissuasion de l’accès au droit, et craignent une explosion du non-recours.
Je refuse cette logique d’écrasement
Je refuse un monde où les plus pauvres doivent supplier pour subsister. Je refuse une administration qui radie avant de comprendre. Je refuse que la France, patrie des droits de l’homme, fasse de la précarité une faute.
Je plaide pour une véritable politique de l’insertion, humaine, sociale, coopérative. Pour des moyens réels alloués aux acteurs de terrain. Pour une écoute sincère des premiers concernés. Pour la reconnaissance de la diversité des parcours et des besoins.
Loin des chiffres, des sanctions et des automatismes, je crois à une solidarité qui relève, et non qui enfonce.