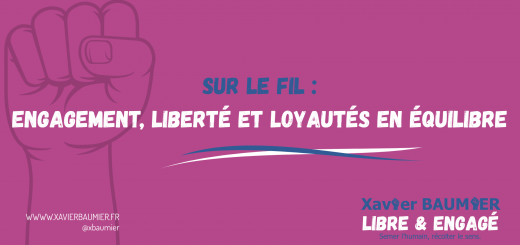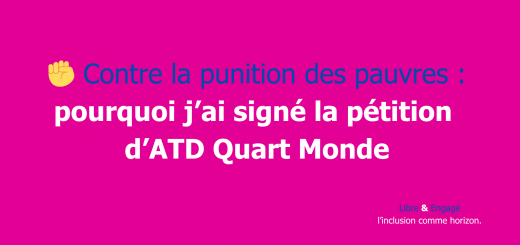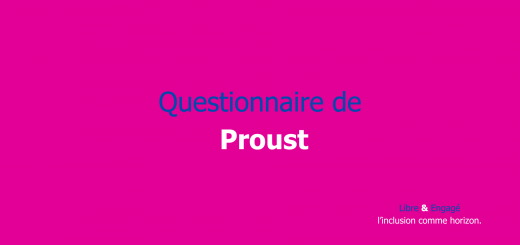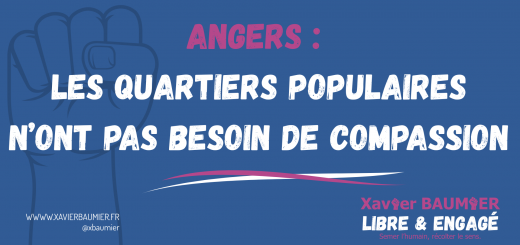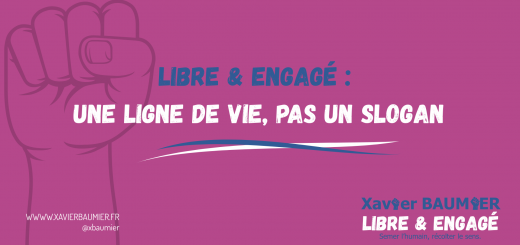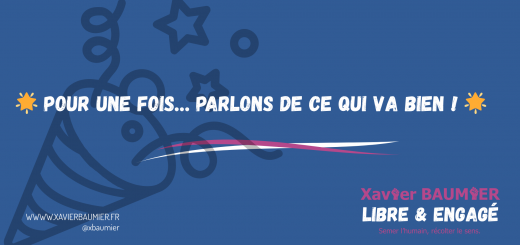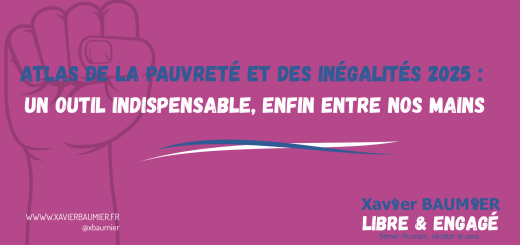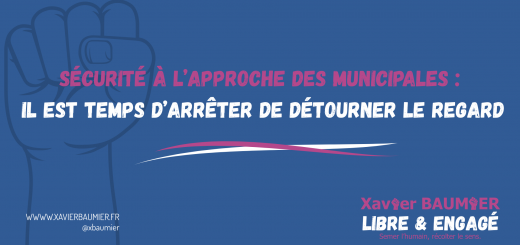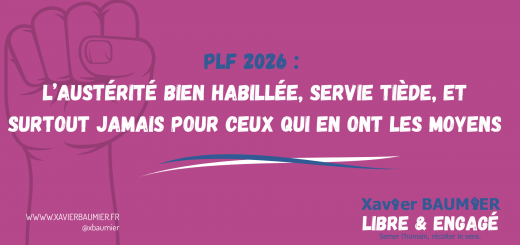✍️ TRIBUNE — Sans espérance, une société se délite. La nôtre y glisse dangereusement.
Quelque chose est en train de se fissurer dans notre pays. Jour après jour, débat après débat, la France semble perdre sa capacité à regarder dans la même direction. Ce n’est pas une fracture nette, spectaculaire. C’est une érosion lente, insidieuse, qui mine notre confiance collective. À force de vivre dans la polémique permanente, dans la colère rentrée ou explosive, dans la méfiance généralisée, nous sommes en train de nous habituer à une forme de découragement partagé. Or une société qui renonce à espérer est une société qui se condamne à subir.
Partout, la tension est palpable. Dans les transports, au marché, dans les familles, sur les réseaux sociaux, la moindre discussion peut s’enflammer en quelques secondes. Tout est sujet à dispute. Un mot, une mesure, un fait divers suffisent à déclencher une avalanche de réactions, souvent excessives, rarement constructives. Cette crispation s’est insinuée dans les replis de la vie quotidienne. Elle est devenue une toile de fond, au point que nous finissons par ne plus la remarquer, comme on s’habitue au bruit d’une machine qui tourne sans arrêt.
Ce climat social tendu est le produit d’une accumulation de crises : sociales, économiques, environnementales, identitaires et politiques. Chacune est lourde à porter ; toutes ensemble, elles forment une charge qui épuise les individus et affaiblit la communauté nationale. Mais à cette lassitude s’ajoute aujourd’hui un élément aggravant : une crise politique institutionnelle d’une ampleur inédite depuis la fondation de la Ve République. Notre système, conçu pour offrir stabilité et clarté, donne l’impression d’avoir perdu sa boussole. Les Premiers ministres se succèdent comme des intérimaires dans une maison sans cap. Les gouvernements naviguent à vue, faute de majorité solide. Le Parlement est morcelé. Les oppositions sont trop souvent dans la posture plutôt que dans la construction. Le Président avance en funambule sur un fil politique de plus en plus ténu. Ce n’est plus une gouvernance, c’est une gestion de l’imprévisible.
Pris dans cette tourmente, les citoyens réagissent comme ils le peuvent. Certains sont en colère — contre les injustices, contre l’impuissance publique, contre le sentiment d’être abandonnés. D’autres se résignent, convaincus que, de toute façon, rien ne changera vraiment. Beaucoup se replient, sur eux-mêmes ou sur leur communauté, pour se protéger d’un monde qu’ils perçoivent comme de plus en plus hostile. Ces attitudes sont compréhensibles, mais elles dessinent une société qui se referme sur elle-même et qui perd peu à peu le goût du collectif. La confiance s’érode à tous les niveaux : dans les institutions, dans les médias, dans la parole politique, mais aussi — et c’est peut-être le plus grave — dans les autres citoyens.
Face à ce tableau sombre, une question simple, presque désarmante, s’impose : et si un peu d’espérance ne nous faisait pas de mal ? Non pas une espérance molle, naïve ou désincarnée. Non pas celle que l’on sert dans les discours de campagne comme un produit électoral. Mais une espérance lucide, volontaire, enracinée dans la conviction qu’un avenir commun reste possible. Une espérance qui refuse le fatalisme ambiant et nous pousse à redevenir acteurs plutôt que spectateurs désabusés.
L’histoire de la France nous enseigne que les grands sursauts collectifs ont toujours été portés par une forme d’espérance partagée. Elle a soudé la Résistance quand tout semblait perdu. Elle a animé la reconstruction après la guerre, dans un pays ruiné mais déterminé. Elle a inspiré les grandes avancées sociales, culturelles et démocratiques de la deuxième moitié du XXe siècle. À chaque fois, ce n’est pas la peur qui a permis d’avancer, mais la capacité de croire que quelque chose de meilleur était possible — et d’agir en conséquence.
Aujourd’hui, cette espérance ne viendra pas d’en haut. Elle ne sortira pas d’un décret ministériel, d’un remaniement gouvernemental ou d’une énième réforme institutionnelle. Elle se construit sur le terrain, dans la société réelle. Elle naît dans les associations qui refusent la fatalité de la précarité, dans les paroisses qui accueillent des familles migrantes, dans les collectifs qui rouvrent des lieux de vie, dans les mobilisations locales où des femmes et des hommes décident de ne pas baisser les bras. Elle prend corps dans ces gestes modestes mais puissants où l’on retisse du lien, où l’on recrée du commun, où l’on choisit de faire société malgré tout.
Redonner une place centrale à l’espérance n’est pas un luxe moral, c’est une nécessité politique. Car sans horizon commun, il n’y a plus de projet collectif possible. Sans confiance minimale, il n’y a plus de démocratie vivante. Sans ce fil invisible qui relie les citoyens entre eux, il ne reste que la défiance, la colère et la fragmentation. Or nous valons mieux que cela.
Il est temps de cesser de subir et de reprendre en main notre récit collectif. L’espérance n’est pas un sentiment passif ; c’est une énergie politique, une manière de tenir ensemble dans la tempête. Elle demande du courage, de la persévérance et une forme de modestie, aussi : celle qui consiste à reconnaître que l’avenir se construit à plusieurs, et que personne, pas même l’État, ne peut le faire seul.
Alors oui, dans cette France fatiguée, fragmentée, parfois méfiante d’elle-même, un peu d’espérance ne nous ferait vraiment pas de mal. Mais surtout, cette espérance ne tombera pas du ciel. Elle dépend de nous. De notre capacité à croire encore, à agir ensemble, à refuser le cynisme comme horizon unique. De notre courage à réinventer un cap commun. Parce qu’une société qui cesse d’espérer cesse aussi, tôt ou tard, d’exister.